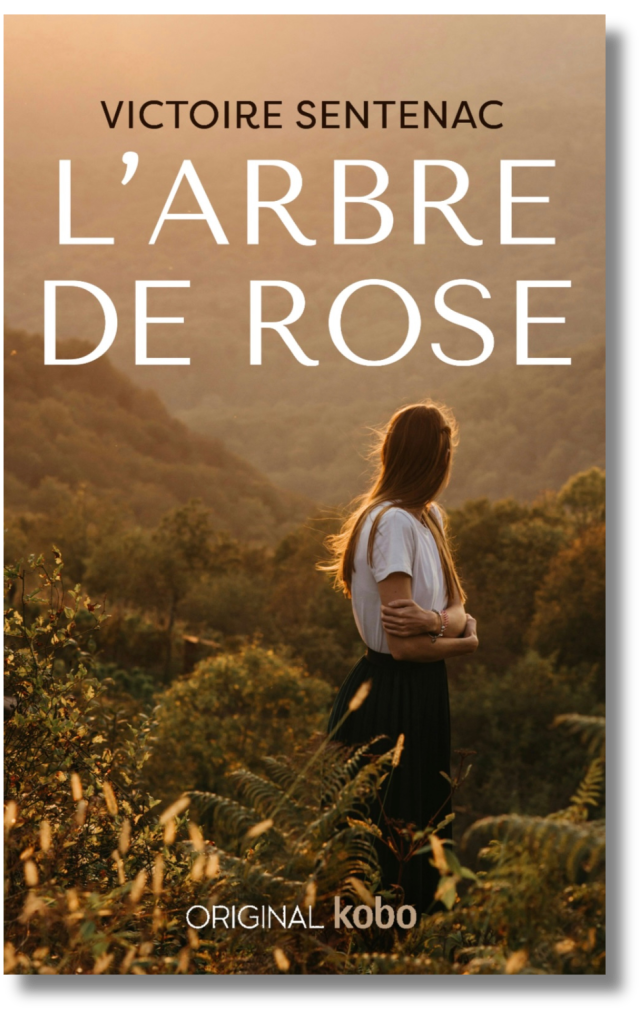Dans Juste après l’orage, l’amour et l’amitié règnent en maîtres. Victoire Sentenac explore avec tendresse et lucidité les parcours de vie accidentés de ses personnages profondément humains, qui entre douleur et reconstruction, rires et larmes, transforment l’ombre en lumière au bout d’un long chemin.
Extrait (5 chapitres)
C’était une belle journée. Une journée sans nuages, une de celles qui vous font aimer la vie plus fort, plus intensément. Une journée qui aurait dû être parfaite.
Rêveuse, je contemplais la spatule de mon ski qui brillait au soleil. Je frottais doucement mes grosses chaussures l’une contre l’autre et tendais l’oreille vers mes voisins de télésiège. C’était un couple qui se querellait, mais comme ils parlaient en italien, je ne comprenais pas tout.
J’offris alors mon visage au soleil en fermant les yeux. Entre la douce morsure du froid et la caresse timide de ses pâles rayons, j’imaginais mon visage en train de brunir, l’éclat que j’aurais en rentrant chez moi et le contraste entre ma mine éclatante et les yeux cernés de mes collaborateurs. La compét’, toujours. Même au beau milieu de mes vacances, elle ne me lâchait pas.
Ma sœur Valentine me détestait quand nous étions petites. Elle finissait par refuser de jouer avec moi car je voulais toujours gagner, quitte à tricher, mentir, la faire pleurer. J’ai des souvenirs un peu honteux de cette époque où je profitais de sa faiblesse, néanmoins nous partagions aussi de grandes joies, et pour moi cela suffisait largement à compenser les peines. Tu m’écrasais, sourit-elle aujourd’hui devant les photos de famille sur lesquelles j’occupe invariablement le premier plan, où j’arbore le plus grand sourire, la pose la plus irrésistible, et le pire c’est que ça marchait ! Le charme opérait, mon père était en adoration devant moi, ma mère ne me refusait rien, j’étais la plus adorable des pestes avec l’assentiment de toute ma famille. Seule ma grand-mère n’était pas dupe. Elle était peut-être la seule à savoir réellement qui j’étais, qui je cachais derrière cette assurance folle.
Ma sœur l’a su aussi, mais bien plus tard.
Nous prenions de la hauteur et je profitais d’un arrêt inopiné de la remontée mécanique pour ôter une de mes moufles, afin de consulter mes messages. Malgré les protestations de mes amis, il était impossible pour moi de couper totalement les ponts avec le monde connecté, même si dans ces fichues montagnes, le réseau était bien trop souvent capricieux. Coup de bol, cette fois-ci, mes cinq barres s’affichaient allègrement.
Le ton montait chez mes italiens surchauffés, ils commençaient à m’agacer prodigieusement, d’où mon besoin de m’extraire momentanément de l’instant présent afin de vérifier que le monde continuait bien de tourner sans moi, même si j’en doutais fortement.
Le soleil d’hiver était radieux, j’avais presque chaud sous ma doudoune matelassée. J’entrouvrais mon col et dégageais un peu mon cou. L’italienne me regarda juste à ce moment-là et je m’étonnais de son expression furieuse. Pensait-elle que je cherchais à séduire son compagnon ? C’était si ridicule que j’envoyais une œillade suggestive par-dessus mes lunettes de soleil au bel italien tout penaud derrière sa harpie. Le ton entre eux monta encore. Je riais sous cape, ça me donnerait une belle occasion ce soir de caricaturer la situation et d’amuser la galerie lorsque nous serions tous rentrés nous mettre au chaud, dans le chalet somptueux qui accueillait notre petit groupe d’amis. Ça aide, de bosser dans l’immobilier, j’étais toujours la première sur les bons plans.
Mes doigts tout engourdis par le froid et crispés sur mes bâtons, que je craignais de lâcher dans le vide, avaient du mal à attraper correctement mon smartphone, je rajustai ma prise et tentai de cliquer sur l’icône de ma messagerie qui débordait de mails non lus. Trois jours seulement que j’étais partie, j’avais pourtant pris soin de confier mes plus gros dossiers à l’une de mes rares collègues en qui j’avais toute confiance, mais visiblement cela ne suffisait pas. J’étais à la fois agacée et profondément satisfaite de constater ce dont j’étais persuadée depuis toujours : j’étais évidemment indispensable.
Qu’il s’agisse de mon boulot ou de ma famille, partout j’occupais la place centrale, celle qui décidait, qui tranchait, qui mettait l’ambiance, le moteur du groupe, le leader.
C’était mon rôle, d’une évidence telle que jamais je n’avais songé à le remettre en question. Pourquoi l’aurais-je fait, d’ailleurs ?
Jusqu’ici, je m’en sortais plutôt bien. Sous-directrice de la plus grosse agence immobilière de luxe du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, un revenu annuel à six chiffres et un réseau croissant dans le monde des affaires et des propriétés de caractère, j’abordais la trentaine en conquérante.
Mes amis naviguaient plus ou moins tous dans les mêmes sphères, et veillaient à entretenir soigneusement les relations utiles à leur carrière, dont je faisais bien évidemment partie. J’en connaissais certains depuis le collège, ce qui me permettait de préserver un peu d’authenticité dans un monde qui en manquait souvent, ce que je reconnaissais mais dont je me fichais royalement.
Signer des mandats, remporter l’exclusivité sur des biens de prestige, trouver la perle rare, l’immeuble ancien que personne n’avait encore jamais visité, voilà ce qui me faisait me lever le matin.
En parvenant enfin à ouvrir ma boîte mail malgré mes doigts gelés, j’aperçus le nom d’une de mes plus grosses clientes du moment, sur un message encore non lu. Mon cœur accéléra, j’adorais ce petit instant d’incertitude, le suspense qui faisait grimper l’adrénaline. Est-ce qu’elle acceptait enfin mes conditions ? Je n’attendais pas une réponse si rapide de sa part à ce moment-là, j’étais à la fois surprise et impatiente d’ouvrir son message.
Il s’agissait d’une propriété de famille, un mas en pierre de toute beauté au pied des Alpilles, avec une vue magnifique sur le village en surplomb. J’avais eu un coup de cœur en visitant les lieux pour la première fois, ce qui ne m’arrivait pas souvent, tant j’étais habituée aux demeures de luxe. Mais je ne sais pas, au cœur de celle-ci j’avais éprouvé une émotion particulière, un bien-être fugace qui m’avait donné envie d’enlever mes escarpins inconfortables et de me poser là, les pieds dans l’eau claire de la piscine à débordement et le nez dans la lavande.
La propriétaire, une dame d’une cinquantaine d’années qui venait de perdre son père, m’offrit un chocolat chaud et nous restâmes là un moment, sous la pergola, à siroter nos boissons sans un mot. Elle aussi semblait émue, pas pour les mêmes raisons j’imagine. Il s’agissait de sa maison d’enfance, le patriarche avait disparu, il fallait vendre pour payer les droits de succession. Une histoire classique. Pourtant, je sentais qu’elle ne me disait pas tout. L’espace d’un instant, le temps s’était arrêté et je m’étais dit que si nous avions été amies, elle se serait confiée à moi précisément à ce moment-là.
Mais je n’étais que l’agent immobilier qui souhaitait vendre au mieux pour que tout le monde gagne un maximum d’argent, elle y compris.
Cette parenthèse envolée, j’avais repris mes esprits en lui assurant que nous avions un gros client qui recherchait exactement ce genre de bien, à condition qu’elle nous en garantisse l’exclusivité. Ce mandat spécifique était essentiel dans l’immobilier de prestige, c’était pourquoi j’attendais son accord impatiemment. Elle m’avait demandé un délai de réflexion d’une dizaine de jours avant de nous faire confiance, or nous étions à moins d’une semaine. Peut-être avait-elle besoin d’une précision supplémentaire ?
Allons bon, voilà que les italiens se faisaient la gueule maintenant. Silence polaire sur le télésiège, qui tardait à repartir. Nous nous balancions au ralenti, à une vingtaine de mètres au-dessus du vide. Je jetai un œil en bas, parcourue d’un léger frisson. Il ne fallait pas tomber maintenant, nous n’étions même pas au-dessus d’une piste. Quelques rares sapins pointaient leurs tristes branches noires sous d’épais paquets de neige fraîche, résistant tant bien que mal à la forte pente, parsemée de roches qui affleuraient à peine à la surface d’une croûte blanche scintillant au soleil. Je plissais les yeux malgré mes lunettes noires, la lumière éblouissante réfléchie cent fois par toute cette neige environnante me donnait le tournis.
Quand même, c’était bien long cette panne. Je tendais le cou pour tenter d’apercevoir Seb et Léa à deux rangées de sièges devant moi, mais ils avaient disparu derrière le sommet franchi. Je me retournais vers la vallée, la cabine de départ était si loin que je ne l’apercevais même plus. Les skieurs stoïques prisonniers de la machine infernale bavardaient gaiement ou bien rêvassaient en espérant des chutes sur la piste voisine, les enfants riaient, un petit malin entonna le refrain de l’Étoile des neiges, pays merveilleux… bientôt repris par la quasi-totalité des passagers, sauf les italiens bien entendu, qui me regardèrent d’un air surpris, comme si j’étais responsable de tout ce bazar.
Mon portable vibra au creux de ma paume. Encore un nouveau message, de l’agence cette fois-ci. Je leur avais pourtant demandé de ne me déranger qu’en cas de force majeure.
Je laissais le délicieux frisson du suspense monter en moi. J’avais beau passer de super vacances, je devais reconnaître que par moments, je m’ennuyais. Lorsque les conversations devenaient creuses, que la soirée s’étirait, ou comme maintenant par exemple, sur ce télésiège dont la panne s’éternisait…
J’avais beaucoup de mal en règle générale à ne rien faire, à ne pas remplir ma vie d’urgences à traiter, de gens à rappeler, de missions indispensables à réaliser et de notifications en tous genres à consulter au plus vite. Mon smartphone, ma tablette et mon ordinateur me sauvaient la vie tous les jours et me préservaient de l’angoisse du désœuvrement.
Pour ce séjour prévu de longue date, j’avais promis à ma petite sœur, qui m’accompagnait pour la première fois, de n’emmener aucun outil de travail, mis à part mon téléphone. Ce n’était pas moi qui conduisais à l’aller, et dès le premier péage passé, j’ai ressenti un vide. Je consultais frénétiquement mon téléphone, espérant le message urgent qui m’obligerait à faire halte pour passer un coup de fil, voire presque à faire demi-tour…
Valentine se moquait de moi bien sûr, mais en attendant je gagnais dix fois mieux ma vie qu’elle, ou presque. Elle était auxiliaire de puériculture dans une crèche, je la plaignais alors de tout mon cœur. Torcher des gamins à longueur de journée pour gagner une misère, non merci. Elle me rétorquait qu’elle avait des projets, qu’elle voulait passer son diplôme d’infirmière pour monter sa propre structure, qu’elle se sentait à sa place au milieu des enfants… Ça me rendait dingue. Je lui avais déjà proposé cent fois de lâcher ce boulot épuisant pour me rejoindre à l’agence, en quelques mois je l’aurais formée, j’étais sûre qu’elle aurait fait une excellente conseillère.
Elle était douce et persuasive, fine psychologue, c’étaient des qualités redoutables dans ma branche. Mais non. Mademoiselle s’obstinait dans son projet de super nounou, j’ai fini par renoncer. Je voyais bien dans l’œil de mes amis le désintérêt total s’installer lorsqu’elle leur annonçait ce qu’elle faisait dans la vie ; au mieux ils embrayaient sur leurs propres déboires à propos de la garde de leurs enfants, au pire ils changeaient rapidement de sujet après une petite moue condescendante.
Ça me faisait toujours mal, même si je ne le montrais pas. Parce que moi, je savais à quel point ma sœur était quelqu’un de formidable.
– Putain, tu vas avancer, ouais ? Allez, sa mère, c’est pas vrai, j’vais encore arriver en retard…
Samia klaxonna avec virulence. C’était sa deuxième semaine à la crèche, elle était encore en période d’essai, et voilà deux jours consécutifs qu’elle se faisait avoir par les bouchons. Elle pesta de plus belle.
– Mais c’est pas vrai, dégage de là, allez ! J’en ai rien à faire de tes livraisons, moi aussi je dois bosser ! Bouffon, va !
Impassible, l’homme en bleu de travail continua ses allées et venues entre sa camionnette et l’arrière-cuisine du restaurant où il déchargeait ses caisses.
Il ne regarda Samia qu’au moment de remonter dans son véhicule et lui adressa un magnifique doigt d’honneur. La jeune femme s’aperçut alors que sa vitre côté passager était restée grande ouverte.
– Tant pis, maugréa-t-elle entre ses dents. T’avais qu’à te dépêcher. Pff…
Cette place en crèche était inespérée, il fallait absolument qu’elle la garde. Ça faisait au moins trois ans qu’elle galérait à faire l’auxiliaire de vie chez des personnes âgées complètement dépendantes, elle se cassait le dos et le moral, sans parler des familles ingrates et toujours plus exigeantes qui la prenaient toutes pour une simple femme de ménage.
Sa dernière expérience avait été la fois de trop. Elle devait s’occuper d’un monsieur de quatre-vingt-deux ans atteint d’Alzheimer, ou de démence sénile, elle ne savait pas trop, mais qui avait complètement perdu la boule. Elle passait son temps à le récupérer chez les voisins, dans la rue, une fois même il avait réussi à échapper complètement à sa vigilance à cause de toutes les tâches ménagères qu’elle devait accomplir, sa famille avait dû le récupérer au poste de police.
Le savon qu’elle avait pris suite à cet incident l’avait atteinte profondément. Elle s’était sentie nulle, pas même capable d’accomplir un travail si simple qu’il ne nécessitait même pas de qualification. Tout comme sa place en crèche d’ailleurs, grâce au manque de personnel ils embauchaient maintenant des jeunes sans aucun diplôme particulier, sous réserve de les former eux-mêmes.
Samia rêvait d’un tel apprentissage depuis qu’elle avait dû abandonner le lycée, à cause de son père qui voulait l’emmener au bled pour la marier de force avec un de ses cousins. Elle avait eu vent de l’histoire grâce à l’indiscrétion d’une tante et s’était enfuie de chez elle, se faisant héberger à droite à gauche par des connaissances plus ou moins fiables. Ses parents avaient eu tellement honte qu’ils n’avaient jamais osé faire appel à la police.
Deux ans plus tard, elle avait atteint sa majorité et la liberté de faire ce qu’elle voulait. Durant les années suivantes, elle avait accompli plus de jobs que d’autres n’en feraient jamais en une seule vie. Distributrice de prospectus, serveuse, nounou, manutentionnaire, vendeuse, danseuse de cabaret, elle avait tout fait. Jusqu’à ce qu’elle découvre le service à la personne et tout ce qu’il impliquait derrière.
Samia, c’était une grande gueule et elle le savait. Mais malgré la dureté de la tâche, ses petits vieux le lui rendaient bien. C’étaient les familles qu’elle ne supportait plus, leurs exigences, leurs regards en biais lorsqu’elle se présentait pour la première fois. « Ah, c’est vous la nouvelle auxiliaire ?» Elle avait envie de répondre, ouais c’est moi la rebeu du coin, ça te pose un problème ? Mais elle ravalait sa langue à chaque fois, il fallait bien bosser, non ?
Quand elle était petite, Samia c’était la boss du quartier, la chef de bande. Fallait pas la chercher. Et dans les cités, ça arrivait souvent. « Ta fille est une rebelle, grondaient les autres mères à l’intention de la sienne, tu devrais la garder chez toi, elle a une mauvaise influence sur nos filles ! »
Lorsque Samia avait été réglée pour la première fois, elle avait été la seule de son immeuble à refuser de porter le voile. Jeans, sweat ample et crinière au vent, elle errait dans les rues, prête à en découdre avec celui qui s’aviserait de vouloir lui passer la corde au cou. « Son père a réagi trop tard, marmonnaient les grincheuses, il aurait dû la renvoyer au bled quand elle était petite, c’est de la mauvaise graine, ça ! »
Oui, son père avait trop attendu, Samia était le fruit tombé bien loin de l’arbre. Pour rien au monde elle ne voulait ressembler à sa mère, dont elle fuyait autant les conseils que les réprimandes. Lorsqu’elle la voyait trimer pour ses frères et son père, s’effacer devant eux, rester coincée dans ce vieil appartement qui puait la graisse rance, à concocter toute la journée des plats marocains sans jamais recevoir aucun merci, aucun signe d’une quelconque reconnaissance, elle voulait lui crier de réagir, de ne plus se laisser faire, de s’enfuir même, pourquoi pas ? Mais c’était impossible. Sa mère aurait été scandalisée par de telles suggestions, elle la voyait comme une mauvaise fille et se demandait quelle faute elle pouvait bien avoir commise pour mériter une telle honte sur sa famille…
Mais épouser un vieil arabe inconnu, vivre cette vie ! Samia en avait des haut-le-cœur. Ce fut un sursaut de désespoir qui lui donna la force de s’échapper, tel un animal pris au piège. En s’enfuyant ainsi, elle avait sacrifié sa jeunesse, ses études ; tout ce qu’elle savait maintenant était ce qu’elle avait appris sur le tas, à force d’observation et de volonté.
Alors, pour une fois qu’on lui servait sur un plateau une vraie formation de cent vingt heures pour une qualification officielle, quelle fierté ! Jamais elle ne renoncerait à une telle opportunité.
Si elle avait pu rouler sur le toit des voitures pour arriver à l’heure, elle l’aurait fait. Mais elle avait beau prendre de l’avance, ces sacrés travaux changeaient tout le temps d’emplacement, elle se faisait avoir à chaque fois.
Cela faisait des années qu’elle n’avait plus de nouvelles de ses parents. Au début, elle s’arrangeait pour croiser une cousine, une tante, des voisins, qui lui confirmaient que tout allait bien dans sa famille. Mais la réciproque ne se produisant pas, elle en avait déduit qu’elle n’existait plus pour eux et avait décidé de faire sa vie toute seule, comme s’ils n’avaient jamais existé.
Elle n’était pas dupe, au fond d’elle-même vivait toujours une petite fille abandonnée, mais elle avait pris soin de la recouvrir de couches durcies par la souffrance et par le temps, étanches à la pitié et à la commisération. Des couches si solides, si épaisses et protectrices qu’elle se laissait le moins possible atteindre par la souffrance d’autrui. Elle faisait son travail en s’occupant de personnes plus faibles qu’elle, mais elle ne les plaignait pas. Elle avait eu son compte de misères, elle aussi. Chacun sa croix.
Lorsqu’elle arriva à la crèche des Lutins à quatorze heures pile, elle soupira d’aise en enfilant ses crocs. Elle avait foncé sur la voie rapide, enfin libre de toute circulation, et regagné les précieuses minutes perdues. Demain, je pars avec une heure d’avance, décida-t-elle.
– Bonjour Samia, lui lança la puéricultrice. Tu es chez les petits aujourd’hui, avec Angélique et Stéphanie.
– D’accord, patronne.
– Et arrête de m’appeler patronne, s’il te plaît.
– OK patr… heu, mais comment je vous appelle alors ?
– Par mon prénom, comme tout le monde ici !
– …
– Tu ne sais pas comment je m’appelle ?
– Franchement, vous êtes combien ? J’vois des nouvelles têtes tous les jours, sans blague.
– Je m’appelle Aurélie, soupira l’infirmière.
– C’est vous qui allez me former ?
– Je ne sais pas encore. Les filles t’attendent, tu devrais y aller, avec les congés en ce moment, c’est compliqué.
Samia haussa les épaules et se dirigea vers la section des tout-petits. Son franc-parler ne plaisait pas ici, elle le sentait. Pas besoin d’avoir fait des études supérieures pour savoir si une atmosphère était bienveillante ou non.
Elle était passée par tant d’endroits, avait rencontré tant de personnes différentes issues de milieux les plus divers, qu’il lui suffisait de humer le vent pour savoir si elle était la bienvenue ou pas. Et ici, ce n’était pas gagné. Son retard de la veille lui avait été durement reproché, pourtant il ne s’agissait que de dix petites minutes dûment justifiées, une autre employée ayant pris la même route qu’elle avait aussi été retardée. Mais les regards en avaient dit long. « Elle est à l’essai, sans qualifications et même pas foutue d’arriver à l’heure, pour qui elle se prend la nouvelle ? »
Samia sentait gronder en elle le vent de la révolte. Allez ma vieille, calme-toi. Elle avait beau se morigéner, ses vieilles rancunes remontaient vite à la surface de sa peau d’écorchée vive.
La seule qui avait vraiment été sympa avec elle était partie dès le lendemain aux sports d’hiver, dommage. Celle-là, Samia n’avait pas oublié son prénom. Valentine l’avait accueillie avec simplicité et gentillesse, comme si elle faisait déjà partie de la maison. Elle lui avait montré les locaux et expliqué grossièrement le fonctionnement de la structure en lui promettant que l’on ne la laisserait jamais toute seule jusqu’à ce qu’elle soit formée. Et puis surtout, elle l’avait présentée à chaque personne croisée comme si elle était une personne importante, et tout le monde l’avait saluée en retour. Samia n’était pas habituée à tant de considérations. Malgré sa carapace, elle en avait été touchée.
Mais Valentine s’était éclipsée et toutes ces pimbêches hypocrites lui faisaient bien sentir tous les jours qu’elle était un boulet, une fille des cités qui ne savait rien et dont il fallait se méfier tant que sa période d’essai n’était pas achevée. Samia avait surpris une conversation dans les vestiaires entre deux auxiliaires de puériculture, outrées que l’on donne à « une fille comme ça » les mêmes prérogatives qu’à celles qui étaient vraiment diplômées, comme elles, sous prétexte qu’elle allait avoir sur le terrain une petite formation de rien du tout. Ça les dévaluait, elles en voulaient à Samia qui incarnait leur fonction au rabais.
La jeune femme s’était retenue de toutes ses forces de ne pas leur voler dans les plumes. Elle se sentait à la fois furieuse et terriblement déçue face au rejet de celles qu’elle prenait déjà pour ses futures collègues.
Marquée du sceau de l’infâmie, est-ce qu’elle sortirait un jour de l’ornière des sans diplômes, sans famille, sans valeur ?
Est-ce qu’elle serait obligée toute sa vie de marquer son territoire avec les dents pour espérer se faire respecter un jour ?
Je finissais presque par m’habituer au silence ouaté des hauteurs enneigées, lorsqu’un vrombissement annonça le redémarrage du télésiège. Quelques hourras retentirent, les italiens recommencèrent à se disputer.
Je me décidai enfin à cliquer de mon index gelé sur le message de Madame Chantal Godefroy. Instantanément, je me retrouvai propulsée dans un autre monde. Un monde où tout allait vite, où le temps valait de l’argent, un monde de compétition où il fallait réfléchir vite et bien, plus vite que la concurrence en tous cas, et savoir s’adapter en toutes circonstances à la demande du client.
Séduire, convaincre, soudoyer, intimider, tous les moyens étaient bons pour parvenir à nos fins, chaque agent privilégiant le sien en fonction de son tempérament. De mon côté, je faisais résolument partie de la team des vainqueurs, la défaite n’était pas envisageable et je ne renonçais jamais à l’obtention d’un nouveau contrat tant que le client ne m’avait pas formellement éliminée, ce qui arrivait plutôt rarement.
C’est pourquoi le message bref et très clair de Mme Godefroy me prit de court.
« Bonjour,
Je vous remercie pour votre intervention au mas mais je préfère ne pas donner suite.
Bonne continuation,
Chantal Godefroy »
Zut ! Et triple zut… Sous l’effet de la surprise, mes doigts gourds avaient imperceptiblement desserré leur étreinte sur mon portable, qui glissa sur la matière synthétique de ma combinaison de ski et passa sous la barre de sécurité pour filer entre mes cuisses, que je serrais convulsivement afin de l’empêcher de tomber.
Mon téléphone, c’était ma vie. Il contenait tous mes contacts professionnels, mes photos, les messages précieux de mes proches et de mes clients, ma connexion aux réseaux sociaux, tous mes mots de passe, mes références bancaires, les applis médicales sur lesquelles je notais soigneusement mon poids, mon cycle menstruel et mes heures de sommeil… Il me servait de boussole, c’était mon fil conducteur, mon doudou, une extension de moi-même. Il ne me quittait jamais, le jour, la nuit, aux toilettes, dans mon bain, en toutes circonstances, c’était à la fois mon outil de travail, mon lien avec le monde et mon antidépresseur ; les notifications en tous genres rythmaient mes journées, mes nuits, mon existence toute entière.
Je le sentais avec angoisse progresser entre mes cuisses pourtant fermement serrées, mais l’épais vêtement de ski ne me permettait pas de le localiser complètement, si j’entrouvrais les jambes il allait tomber dans le vide, il fallait tenir jusqu’à l’arrivée pour espérer le récupérer.
Nous étions presque au niveau d’un pylône lorsque le télésiège repartit franchement, ce qui provoqua un soubresaut de notre siège, qui se balança d’avant en arrière avant de franchir les rouages du câble aérien dans un vrombissement saccadé. L’italienne poussa un petit cri de frayeur, et je sentis avec horreur mon téléphone glisser comme un petit poisson chaud entre mes jambes.
– Oh, il tuo telefono !
Son compagnon pointa du doigt le trait étincelant de mon portable qui chutait dans le vide. Je poussai un non ! désespéré et me retournai frénétiquement sur mon siège pour repérer le minuscule point noir dans la neige, vingt mètres plus bas, qui s’éloignait de seconde en seconde.
Je tentai d’oublier la panique qui gagnait mon cœur et me concentrai sur son emplacement. Entre un rocher et un sapin dégarni, juste après une grosse plaque de verglas… Je décidai de compter les pylônes qui nous séparaient de l’arrivée, et d’ignorer le demi-sourire satisfait de cette saleté d’italienne, qui tenait là une belle revanche.
Je ne voyais et ne sentais plus rien ; ni la beauté des cimes enneigées qui me transportaient la minute d’avant, ni la blancheur scintillante des pistes voisines, ni la douceur sur mon front des timides rayons d’un soleil de février…
La magie de l’instant s’était envolée. J’avais perdu mon téléphone et plus rien ne comptait. Je devais le récupérer, quoi qu’il arrive.
À l’arrivée, je bondis de mon siège et m’élançai vers la gauche, à l’opposé de Seb et Léa qui levèrent leurs bâtons de ski en me faisant signe de les rejoindre. Je les ignorai et scrutai la piste en calculant le moyen le plus direct pour atteindre la zone où mon portable était tombé. Voyant que je ne bougeais pas, mes amis me rejoignirent en pas de patineur.
Essoufflée, Léa fronça les sourcils.
– Qu’est-ce que tu fabriques ? On avait dit qu’on prenait la rouge, c’est à droite !
– J’ai perdu mon téléphone, je dois aller le récupérer.
– Oh mince ! Tu l’as fait tomber où ?
– Au niveau du sixième pylône en partant d’ici, j’ai pris un repère, ça va aller.
– Tu te fiches de nous ? répondit Seb. Si je compte bien, il est tombé derrière les rochers, dans la montée, c’est carrément inaccessible !
– Je m’en fous ! J’irai à pied s’il le faut, hors de question d’abandonner. J’en ai trop besoin.
– Liz, je suis désolé pour toi, je sais que ça va être compliqué, mais tu dois laisser tomber. C’est beaucoup trop dangereux.
Je ne l’entendais même pas. Une partie de mon cerveau lui donnait raison, j’avais vu de mes propres yeux la pente presque à pic, les rochers, le hors-piste… Mais une voix en moi m’ordonnait d’y aller, je ne pouvais physiquement pas renoncer. Je devais au moins essayer.
D’un mouvement rageur, je les plantai là et descendis la piste qui me paraissait la plus proche du lieu où ce fichu téléphone était tombé. Je comptai les pylônes et m’arrêtai juste avant le sixième, découragée. J’en étais si loin !
Seb avait raison, comment rejoindre cette zone sauvage sans matériel, et surtout sans aucune expérience de la montagne ? Je risquais de provoquer une avalanche, de tomber dans une crevasse, ou encore de dévaler jusqu’à la station sans parvenir à me retenir à quoi que ce soit…
Seb et Léa me suivaient de près.
– Alors, tu vois bien par toi-même que c’est impossible là, non ?
Je restai silencieuse. Est-ce que je mesurais les risques encourus ? À ce moment-là, me rendais-je vraiment compte de ce que je mettais en balance ?
Fermée à tout argumentaire raisonnable et obnubilée par la perte de cette extension indispensable de moi-même, je réfléchissais avant tout à la meilleure façon de rejoindre la zone convoitée. Je décidai de redescendre jusqu’en bas de la piste pour reprendre le même télésiège et étudier à nouveau le terrain. Je n’étais pas habituée à perdre, ni à renoncer au premier obstacle venu. Je prenais tout cela comme un nouveau défi à relever.
Perplexes face à tant d’opiniâtreté, mes amis semblaient partagés entre agacement et colère. Ils m’en voulaient de leur imposer mes quatre volontés, mais je sentais qu’ils respectaient aussi ma force de caractère.
J’avais toujours fonctionné ainsi, en fonceuse, entraînant dans mon sillage les indécis, les défaitistes, les peureux. Je ne les jugeais pas, je me sentais juste différente d’eux. Je ne cherchais pas non plus à les comprendre.
Résignés, Seb et Léa me suivirent jusqu’à la queue du télésiège, qui grossissait de minute en minute. Je ne décrochai pas un mot. Je n’avais même pas eu le temps de répondre à Mme Godefroy ! Si ça se trouvait, elle était déjà en train d’appeler une autre agence et de confier son bien à des incompétents qui lui avaient promis la lune. Je n’envisageais pas qu’elle ait pu renoncer à vendre. Unique héritière, le montant des droits de succession à acquitter était faramineux. Elle m’avait laissé entendre que le mas était le seul bien immobilier du patrimoine de son père, elle n’avait donc pas d’autre choix que de s’en séparer, à moins de disposer de plus d’un demi-million d’euros sur son compte en banque…
Il fallait impérativement que je la joigne, ou ma plus belle commission de l’année allait me passer sous le nez. Je demandai à Léa de me prêter son portable.
– Tu veux appeler qui ? me demanda-t-elle sur un ton suspicieux.
– L’agence. C’est urgent.
– Ils ne peuvent pas se passer de toi, même pendant quelques jours ?
– C’est plutôt elle qui ne peut pas se passer d’eux, ironisa Seb.
J’ignorai leurs clins d’œil moqueurs et composai en vitesse un des seuls numéros que je connaissais par cœur.
– Salut Béa, c’est Liz. Non, ça ne va pas, je viens de perdre mon portable, donc si urgence tu m’appelles sur celui-là, OK ? Envoie-moi le numéro de Mme Godefroy par sms s’il te plaît. Le mas dans les Alpilles. Oui, maintenant !
Je m’impatientai. Notre hôtesse d’accueil était sympa, mais trop longue à la détente. De manière générale, je trouvais toujours les gens d’une lenteur exaspérante.
Je scrutais l’écran en attente de son message, il arriva pile au moment où nous nous installions sur le siège en cuir rembourré qui nous emporta à nouveau vers les sommets. Je tentai d’amadouer Léa pour qu’elle m’autorise à téléphoner pendant la montée, mais elle refusa catégoriquement, ce que je pouvais comprendre. Un seul portable par-dessus bord, c’était nettement suffisant.
– Il est là ! m’exclamai-je comme si j’avais trouvé un trésor.
Mon cœur s’emballait, pour un peu j’aurais bien sauté par-dessus la barre de sécurité. Pragmatique, Seb calculait nos chances de pouvoir le récupérer, mais il arriva aux mêmes conclusions que tout à l’heure.
– Liz, c’est de la folie, tu prendrais bien trop de risques. Regarde, rien que pour rejoindre la zone depuis la piste balisée, tu devrais passer par les rochers à pic, sans matos d’escalade c’est impossible.
Il pointait le gant de sa main gauche d’un air docte, plissant son nez pour faire remonter ses lunettes de soleil qui glissaient à cause de la crème dont il s’était tartiné le visage. Je voyais bien que pour lui, une telle ascension n’était même pas envisageable. J’étais une petite fille capricieuse, qu’il fallait simplement ramener à la raison. En même temps, Seb était le mec raisonnable du groupe, celui qui pesait le pour et le contre entre une salade frisée et une batavia quand on faisait les courses, et Léa se rangeait toujours à son avis. Leur couple était un mystère pour moi ; si sages, posés, ils me faisaient penser à ces animaux qui vivent toute leur vie ensemble sans se poser de questions, comme les castors ou les inséparables.
– Et si je faisais le tour par l’autre côté ? En prenant la rouge et en faisant un petit détour, je peux passer par la forêt et me repérer grâce aux pylônes…
– Ça ne change rien, tu auras la même pente à l’arrivée… Laisse tomber, avec tout le fric que tu gagnes, tu peux quand même te racheter un téléphone, non ?
Je boudais. Ils ne comprenaient rien. Pour eux qui bossaient dans une banque, la même évidemment, une semaine sans portable c’était une simple contrariété, pour moi c’était le monde qui s’écroulait.
Enfin, à ce moment-là c’était encore ainsi que je voyais les choses.
– Reviens tout de suite ! Tu vas les réveiller !
– Mais il pleure, je dois le laisser comme ça, tout seul dans son lit ?
– Et alors ? Tu préfères un seul gamin qui braille ou bien dix ?
– Je préfère neuf qui dorment et un dans mes bras.
Sans tenir compte des remontrances de sa collègue encadrante, Samia entra dans le petit dortoir sombre et se faufila jusqu’au lit à barreaux dans lequel s’agitait Marius.
Quand un bébé de quatre mois se mettait à chouiner, ce n’était pas la peine d’avoir un diplôme pour savoir qu’il avait besoin d’être câliné. Mais c’était la pause-café pour les deux auxiliaires, ce moment où elles se racontaient leur vie en évoquant des événements aussi insipides que leur menu du soir ou leur prochaine couleur chez le coiffeur. Alors ce bébé récalcitrant à la sieste les enquiquinait, tout simplement.
Samia n’en revenait pas de la façon dont certaines d’entre elles, pourtant mères de famille, traitaient les gosses ici. Lorsqu’elle habitait encore chez ses parents, elle s’occupait de ses petits frères, de ses neveux et nièces, de ses cousins, des voisins, peu importait leur âge et leurs besoins ; elle s’adaptait et agissait avec eux aussi naturellement que si elle était leur mère à tous, avec justesse et bon sens malgré son jeune âge. Il lui arrivait de les gronder, parfois même de les punir, mais jamais de les négliger ou de leur imposer sa volonté uniquement parce qu’elle était plus âgée qu’eux.
Elle avait trop subi la tyrannie de son propre père pour appliquer à son tour cette détestable loi du plus fort qui sévissait dans la cité où elle vivait. Depuis qu’elle en était partie, elle découvrait néanmoins avec amertume que l’autoritarisme et l’injustice n’avaient pas de frontières, et frappaient sans distinction tous les milieux sociaux, toutes les catégories professionnelles.
La preuve dans cette crèche des Lutins, quelle hypocrisie, songeait-elle. Ils étaient tous à faire des ronds de jambes devant la directrice, mais par derrière c’était encore une fois la loi de la jungle qui s’appliquait…
C’était à qui était la plus maligne pour tirer au flanc sans s’attirer les foudres de ses collègues, qui n’en faisait qu’à sa tête pour choisir sa section, ses dates de vacances, le programme d’activités du jour…
Depuis qu’elle était arrivée, Samia observait cette ronde, notant les forces et les faiblesses de chacune. Ses futures collègues le sentaient, mal à l’aise, et profitaient de chaque occasion pour la rabaisser et se faire mousser, c’était facile avec une fille comme elle, rongée de complexes et dévorée par un sentiment d’imposture qu’elle combattait à coups d’insultes, tous pics dehors.
Elles n’étaient pas toutes désagréables avec elle cependant, dans chaque groupe se trouvait au moins une fille sympa, souvent peu diplômée, et puis il y avait l’exception qui confirmait la règle, comme l’auxiliaire Valentine qui l’avait accueillie, ou encore Mathilde, une éducatrice qui semblait s’intéresser sincèrement au parcours de Samia et qui lui donnait chaque jour de nouvelles astuces pour s’occuper au mieux des enfants.
En l’occurrence, Mathilde ne lui avait jamais conseillé de laisser pleurer un bébé pendant l’heure de la sieste, sous prétexte qu’il fallait le réguler et que l’on n’avait pas le choix.
Bravant les réprimandes, Samia se pencha sur le petit lit de Marius et ramena le bébé tout contre elle ; il se calma aussitôt. « Tu vas te faire bouffer toi », ricanèrent les deux collègues depuis la porte ouverte sur la petite cour, cigarette au bec et gobelet fumant de café à la main.
Bande de nazes, grommela-t-elle pour elle-même, étouffez-vous avec vos clopes, c’est moi qui vais vous bouffer toutes crues. Elles connaissent pas leur chance, ces dindes, d’avoir un CDI et un diplôme d’état.
Comme s’il allait se rendormir, le pépère ! Hein mon coquin, t’es une petite canaille toi, j’t’ai à l’œil mon bonhomme, ouais c’est ça fais-moi du charme maintenant avec tes fossettes et tes grands yeux, t’as de la chance, t’es drôlement mignon, chuis obligée de m’occuper de toi maintenant, alors tiens-toi à carreaux, hein ?
Lorsque la mère de Marius vint le chercher, elle le trouva particulièrement calme et souriant. Il avait passé la moitié de la journée dans les bras de Samia et portait encore sur lui son odeur de vanille. Ravie, la jeune maman la remercia chaleureusement. Ce fut une belle victoire pour Samia, avide d’une reconnaissance qui n’allait manifestement pas venir de ses pairs, et cela la conforta dans l’idée qu’il valait parfois mieux écouter son instinct que de vouloir plaire à ses semblables à tout prix. Elle allait toutefois apprendre à ses dépens qu’il ne s’agissait pas d’une règle absolue.
En rentrant chez elle après la fermeture de la crèche, et passées les remontrances adressées par l’équipe aux parents retardataires, Samia pria pour que sa voiture ne la lâche pas durant le mois qui arrivait, pas avant qu’elle ne touche son premier salaire complet. Elle avait enchaîné de petites missions mal payées ces dernières semaines, et mises bout à bout, les indemnités versées par sa boîte d’intérim devaient à peine couvrir son loyer, pourtant très raisonnable ; certes, elle avait quitté les barres d’immeubles de la cité, mais le quartier dans lequel elle vivait n’était pas particulièrement résidentiel.
Elle habitait un petit logement social au sein d’un immeuble de quatre étages, dont l’escalier puait la pisse de chat et les relents de cuisine bon marché. Mais c’était chez elle, et ça n’avait pas de prix. Elle mettait d’ailleurs un point d’honneur à s’acquitter de son loyer en temps et en heure, quitte à manger des pâtes ou de la semoule durant les jours suivants.
Samia gara sa vieille Clio sur l’emplacement à moitié effacé d’une place réservée aux handicapés, jouant sur le bénéfice du doute. Elle ne se sentait pas concernée, à vrai dire elle n’avait jamais connu personne en situation de grand handicap ; ce qu’elle en savait se résumait essentiellement à la perte d’autonomie liée à l’âge ou à la maladie. Elle ne manquait pas particulièrement de compassion : elle n’y pensait tout simplement pas.
Elle frissonna en sortant de sa voiture, dont le chauffage au moins fonctionnait parfaitement. Resserrant les pans de sa veste bien trop fine pour la saison contre sa poitrine généreuse, elle calcula mentalement la somme dont elle pourrait disposer pour s’acheter un manteau digne de ce nom avant que les soldes de début d’année n’aient épuisé tous les stocks. Samia aimait les beaux vêtements, elle ne pouvait passer devant un magasin Kiabi sans avoir la nausée. Sa mère l’avait tellement traînée là-dedans lorsqu’elle était petite… Alors maintenant qu’elle avait la possibilité de choisir, elle préférait patienter et mettre de l’argent de côté pour s’acheter une belle pièce, plutôt qu’un manteau bon marché quelconque. En attendant, certes elle avait froid, mais avec style.
– Salut ma belle ! Tu m’oublies pas, hein ?
– Salut Momo, mais non t’inquiète je t’oublie pas … Qu’est-ce que tu fous encore dehors à cette heure-ci, allez rentre chez toi !
Le vieil homme édenté sourit aux anges, Samia l’aidait à se connecter sur WhatsApp pour appeler ses enfants chaque mercredi soir, et nous étions mercredi. Il n’y voyait pas bien clair, lisait approximativement et surtout refusait de comprendre quoi que ce soit à la technologie. Samia le sermonnait pour la forme, mais elle finissait toujours par rire avec ses enfants, qu’elle avait appris à connaître via l’application, se moquant avec eux de leur père.
Durant ces appels vidéo, c’était Adel qui participait le plus. Fils aîné de Momo, il faisait toujours durer la conversation en s’adressant plus particulièrement à Samia, lui demandant des nouvelles de son travail, de ses amis… Elle répondait volontiers. Il avait de beaux yeux noirs Adel, aux cils sombres et recourbés. Et puis sa voix était douce comme du velours, pas comme celle des hommes qu’elle connaissait. Mais ces échanges ne duraient pas, elle n’y arrivait pas. C’était bizarre, cette sorte d’intimité avec un inconnu, un homme qu’elle n’avait jamais rencontré et qui n’était rien pour elle.
Alors elle tournait le téléphone vers Momo, lui demandait d’embrasser ses enfants et s’en retournait dans son petit appartement, dont elle laissait la porte entrouverte pour se sentir moins seule. Elle n’avait pas peur.
Durant deux ans, Samia avait presque vécu dans la rue, alternant entre les locaux associatifs et les haltes de nuit mises à disposition par le Samu social. Elle était connue des équipes de maraude, jusqu’à ce qu’elle trouve enfin un job qui la stabilise suffisamment longtemps pour qu’elle obtienne un bail.
Alors maintenant qu’elle était sédentaire, ce n’était pas quelques voisins bruyants ou même alcoolisés qui allaient l’effrayer, elle en avait vu d’autres. Non, le pire c’était la solitude. Ça vraiment, elle ne s’y faisait pas.
En fuyant ses parents, Samia avait quitté aussi toute une communauté, une vie de groupe au sein de laquelle elle s’était construite ; même dans la rue il existait une forme de solidarité. Alors vivre seule, ne penser qu’à elle, ça lui semblait certains soirs au-dessus de ses forces.
Parfois, elle se faufilait chez ses voisins pour le dernier thé de la journée et faisait semblant de s’endormir sur leur canapé. Elle ne se détendait complètement que lorsqu’elle sentait la chaleur d’un plaid recouvrir ses épaules, posé gentiment sur elle par une grande sœur ou une mère qui ne lui posaient pas de questions. Une fille seule, sans famille, ça n’existait pas. Alors on ne voulait pas savoir, on accueillait, c’était tout.
Et le matin suivant, on lui offrait du pain d’olive, des dattes et un verre de thé bien sucré avant qu’elle ne retourne chez elle prendre une douche et filer à son travail, voir des gens, côtoyer d’autres misères.
Non, Samia n’était vraiment pas faite pour vivre seule.
Seb ne changea pas d’avis. Lassé par mon obstination déraisonnable, il me rappela que nous avions rendez-vous à midi pétantes au restaurant d’altitude avec les autres, qui avaient préféré s’octroyer une grasse matinée après notre raclette bien arrosée de la veille, suivie d’une petite soirée dansante improvisée et de quelques joints fumés en douce sur le balcon enneigé de notre beau chalet.
Autant dire qu’il n’y avait eu que le sage couple d’inséparables et moi-même, l’hyperactive de service, pour démarrer envers et contre tout notre journée de ski à l’ouverture des pistes.
Pour une fois, si j’avais su ce qui m’attendait, j’aurais mieux fait de rester au lit.
Le ciel était clair, aucune chute de neige n’était prévue avant la nuit. Je consentis donc à les suivre, tout en élaborant dans ma tête le meilleur plan possible pour aller chercher mon portable ; malgré les arguments pourtant sensés de mes amis, je refusais de lâcher l’affaire. Je projetais d’y retourner toute seule, de laisser mes skis sur la piste balisée et d’y aller à pied en suivant une ligne transversale, perpendiculaire à la pente.
Certes, j’étais d’accord avec Seb, la déclivité était importante. Mais j’étais sportive, j’avais fait de l’escalade en salle quand j’étais ado, et je n’étais pas une froussarde.
Je me demandais vaguement si je cultivais mon intrépidité pour masquer les tocs dont je souffrais, ou à l’inverse si c’étaient mes névroses qui me poussaient à commettre des actes insensés afin de les combattre.
Au fond, je me demandais parfois si quelqu’un sur cette terre me connaissait réellement. Ma petite sœur Valentine, dont je me sentais pourtant proche, ignorait elle aussi qui se cachait derrière l’écran de cette personnalité solaire qui remportait tous les suffrages. Je tenais trop à me voir forte dans ses yeux, comme dans ceux de tous mes proches ; lorsqu’il m’arrivait de flancher, c’était à leur déception que je pensais, et la terreur de me dévoiler à eux comme une fille faible et vulnérable me faisait repousser mes limites toujours plus loin.
Mon corps, pas dupe, m’envoyait parfois des signaux, de plus en plus visibles, de plus en plus puissants, que je m’obstinais à ignorer, pratiquant avec constance une politique de l’autruche que j’imaginais diablement efficace.
C’était aussi pour ces raisons-là que je fuyais la lenteur, la sensation de vide, de solitude, l’inertie. Être toujours en mouvement me permettait de ne pas ressentir à quel point ma vie manquait d’épaisseur. J’esquivais les rares moments de lucidité durant lesquels je reconnaissais avoir besoin d’aide, moi aussi. C’était trop douloureux, trop dangereux surtout. Cela aurait pu mettre en péril la vie rêvée que je m’étais construite, jour après jour, brindille après brindille, comme un oiseau bâtit son nid.
Et puis je m’arrangeais pour que mes bizarreries concordent avec l’énergie qui me caractérisait. Mes proches me taquinaient sur mon obsession de la propreté par exemple, mettant sur le compte de mon perfectionnisme cette rage de ménage qui me faisait briquer mon intérieur en toutes circonstances, y compris dans notre chalet de vacances.
Ce qu’ils ignoraient, c’étaient les convictions absurdes qui accompagnaient mes frénésies de propreté, que je me gardais bien de partager. Reconnaître à voix haute, même pour moi seule, que si je ne passais pas un coup d’éponge six fois au même endroit sur la table, ou bien si j’oubliais une seule petite miette, l’un de nous courrait un grave danger… Non, ça n’était pas envisageable.
C’était mon moi secret, celui que je gardais à l’abri des regards depuis que j’étais toute petite, tout comme je restais persuadée que mes faits et gestes étaient observés par quelqu’un d’invisible, comme une caméra cachée qui surprenait la moindre de mes pensées, une sorte de censeur secret qui n’était autre que moi-même, rigidifiée dans un carcan de convictions qui me faisaient me tenir droite.
Lorsque nous arrivâmes au resto d’altitude, Valentine, Guillaume, Juju et Sarah nous accueillirent avec une ola digne des plus grands stades. On ne passait pas inaperçus ! Ils avaient attaqué l’apéro à grands renforts de bières et de barquettes de frites arrosées de mayonnaise, et se plaignirent du temps que nous avions mis à les rejoindre.
– Demandez à Liz pourquoi on est en retard ! leur répondit Seb en me regardant de travers.
– Oh, ça va… J’ai perdu mon portable sur le télésiège des Marmottes, je voulais essayer d’aller le récupérer, c’est tout.
– Aïe, grimaça Valentine. Tous aux abris, je vous préviens, Liz sans son téléphone c’est le retour du Grinch !
– Sans déconner, il est irrécupérable ? demanda Juju, compatissant.
Lui aussi était accro à son portable.
– Moi je pense qu’il y a une chance, mais selon Seb c’est mort.
– Oublie, confirma-t-il en s’essuyant la bouche après avoir bu une longue gorgée de bière brune. Beaucoup trop dangereux, il est tombé au niveau des rochers.
– L’avantage, c’est qu’on ne te le piquera pas.
– Ah ouais c’est sûr que c’est un super avantage, t’en as d’autres des réflexions aussi intelligentes ?
– Bon sang, elle a raison ta sœur, c’est le réveil du Grinch, allez Liz c’est pas la fin du monde, commandes-en un autre dès aujourd’hui, tu l’auras en rentrant…
Valentine me regarda d’un œil tendre et vaguement inquiet, elle savait que je bouillonnais au fond de moi, me retenant de ne pas tous les envoyer bouler. Elle me tendit son téléphone, un modèle si vieux que je me promis de lui en offrir un nouveau à elle aussi si je ne retrouvais pas le mien.
– Je suis sûre que tu as des coups de fils urgents à passer, t’as qu’à donner mon numéro et le garder, télécharge aussi ton adresse mail si tu veux.
– Et toi, tu n’en as pas besoin ?
– Je l’allume un jour sur deux alors franchement, je pourrais même m’en passer complètement. C’est cadeau !
J’étais incrédule mais au fond, cela ne m’étonnait pas tant que ça. Nous étions si différentes, toutes les deux. Valentine était une rêveuse, une idéaliste. Un peu artiste dans l’âme, toujours à s’inquiéter du bien-être d’autrui, elle en oubliait de construire son propre bonheur, son propre nid. Elle se moquait de mes valeurs concrètes, de mon compte en banque bien garni, mais je constatais qu’elle était heureuse aussi de profiter de ces quelques jours de vacances à la montagne, un séjour qu’elle n’aurait jamais pu s’offrir avec son salaire d’auxiliaire en crèche. Je ne comprenais pas comment elle pouvait prétendre s’épanouir dans ces conditions. Je pensais qu’elle mentait, par fierté, comme je l’aurais fait si j’avais été dans sa situation.
Je composai le numéro de Mme Godefroy et m’éloignai du groupe pour parler au calme. Je revêtis instantanément mon uniforme de sous-directrice intangible et séductrice, comme une seconde peau qui ne m’aurait jamais quittée.
– Madame Godefroy, comment allez-vous ? C’est Liz, de l’agence Taylor & Barnes. J’ai bien reçu votre message, je suis certaine qu’il s’agit d’un malentendu, allons, dites-moi ce qui vous arrive…
Prise de court, la cliente m’annonça qu’elle perdait tous ses repères depuis le décès de son papa, que cette maison de famille était le seul bien qui lui restait de son enfance, et que si elle le vendait maintenant, elle se sentirait dépossédée d’elle-même. Elle avait besoin de vivre dans cet endroit, de s’en imprégner, pour peut-être un jour parvenir à lui dire aurevoir.
Je restai sans voix. Certes, j’avais moi-même été touchée par la quiétude et la majesté du lieu, je comprenais fort bien qu’il puisse représenter une personne qui lui était chère, en l’occurrence son père, et qu’elle ait du mal à s’en détacher, mais de là à se mettre en danger financièrement pour le garder, non je ne comprenais pas.
Je tentai froidement de lui faire entendre raison, lui rappelant le délai de six mois dont elle disposait pour s’acquitter des droits de succession, que passé cette date butoir sans avoir signé de compromis de vente, elle devrait en outre payer des intérêts de retard sur la somme due, qui était déjà astronomique, même en sous-évaluant le mas…
Elle me coupa la parole, me répondant d’une voix lasse, comme elle aurait parlé à un petit enfant incapable de comprendre des choses pourtant simples.
– Je sens bien que ça vous dépasse, mais je ne changerai pas d’avis. Je me débrouillerai, je ferai un emprunt, je louerai ma maison… J’ai besoin de comprendre certaines choses de mon passé, et les réponses se trouvent ici, voyez-vous. Il est temps pour moi de regarder en face l’histoire de ma famille et d’arrêter de répéter indéfiniment les mêmes erreurs.
Je ne comprenais rien à son charabia. Déçue et vexée de ne pas parvenir à la convaincre de revenir sur sa décision, j’abrégeai la conversation et revins m’assoir auprès de mon groupe, la mine sévère.
– Ouh la, les affaires ne reprennent pas comme tu l’espérais, on dirait, me taquina Guillaume.
– Sans blague, comment t’as deviné ? Pff, une vraie conne cette cliente, quand elle se fera saisir par le fisc et qu’on vendra son bien au rabais, faudra pas qu’elle vienne pleurer…
– Allez, bois un coup ma Liz, et oublie un peu tes clients pour une fois ! Profite, si tu en es encore capable.
Cette petite phrase m’avait percutée de plein fouet. Guillaume, c’était mon meilleur ami, mon amant, mon âme sœur. Malgré ce qu’il prétendait, je le soupçonnais d’être amoureux de moi depuis des années, lui qui enchaînait les conquêtes d’un soir sans jamais s’engager, espérant sûrement qu’un jour j’en aurais assez de notre amitié ambiguë ponctuée de soirées sex friend comme on les appelait…
Les soirs de blues, de solitude, les fins de journée moroses, ou tout simplement lorsque cela faisait trop longtemps que l’on était chastes l’un et l’autre, on s’appelait et on se faisait un plateau tapas télé, qui se finissait irrémédiablement par une partie de jambes en l’air torride.
L’alchimie entre nous était électrique, nos peaux s’accordaient à merveille et nous savions parfaitement comment faire grimper l’autre aux rideaux. Avec Guillaume, je n’avais jamais ressenti de limites, ni honte ni dégoût. On se respectait mais on savait aussi écouter nos envies ; lorsque l’excitation prenait le dessus, plus rien ne comptait. Ces soirées étaient comme les soupapes de sécurité de nos quotidiens débordés. Guillaume était urgentiste, soumis à un stress permanent, mais tout comme moi je savais qu’il avait besoin de cette adrénaline pour des raisons obscures.
La seule limite à nos échanges secrets, qui ne l’étaient au fond pour personne, c’était de ne pas tomber amoureux l’un de l’autre. On ne souhaitait ni s’engager, ni perdre notre superbe amitié. Alors nous avions trouvé cette solution bancale, et croyions-nous efficace, de nous confier en toute sincérité sur l’histoire de nos vies, de ne coucher ensemble que lorsque nous étions tous deux célibataires, et de nous soutenir envers et contre tout.
Guillaume était un peu mon alter ego au masculin, solaire, drôle, fort en gueule ; nous n’hésitions pas à reconnaître que nous étions pathétiques l’un et l’autre avec notre phobie de l’engagement et notre obsession pour notre carrière… Mais on se l’avouait seulement lorsque nous n’étions que tous les deux, et dans le même état d’esprit. Alors me balancer ainsi devant tout le monde que j’étais incapable de profiter de la vie m’avait atteinte. Quel message m’envoyait-il ?
ENVIE DE LIRE LA SUITE? 💕 C’est par ICI
Écrivain
Victoire Sentenac