« Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants. »
Jean d’Ormesson
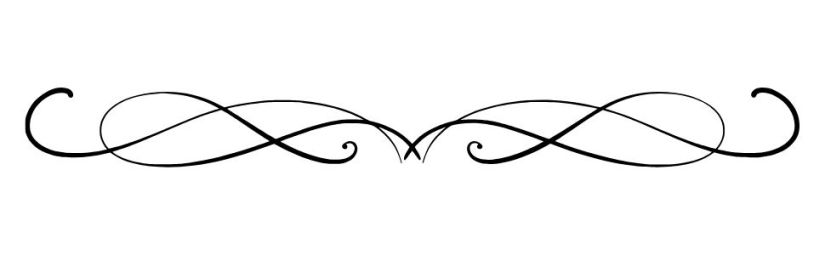
1
Armentières, 18 mai 1940
Jeanne tremble en découpant les parts de gâteau.
Elle veille à ce qu’elles soient bien égales afin de ne pas déclencher un concert de protestations entre ses enfants, même si Gaspard estime, étant le roi de la fête, qu’il en mériterait bien une un peu plus grosse que celle des autres, tout de même. Cinq ans, ça n’est pas rien !
Il se sent très fier à cette idée et, quand on lui demande son âge, il tend la main devant lui en écartant bien fort tous ses doigts pour appuyer ce chiffre magique, cinq ! Comme les cinq doigts de la main, et il est très habile de ses mains, le petit Gaspard. Lorsqu’il joue aux osselets avec sa sœur Apolline, qui a pourtant atteint l’âge de raison, c’est presque toujours lui qui gagne.
Assis en tailleur sur le carrelage froid de la cuisine, les jambes écartées, genoux repliés et sourcils froncés, ils se défient l’un l’autre en lançant en l’air les petits os de métal polis par le temps, dont le cliquetis sec les rassure et les amuse tout à la fois. Gaspard s’entraîne seul, aussi, ce qui lui a valu ce matin de remporter la partie contre Apolline, une fois de plus, sur une « triple » en ramassant les trois osselets d’un coup tandis qu’il lançait en l’air le quatrième de sa main gauche. La moue dépitée de sa sœur l’a bien fait rire. Il n’y peut rien si elle est si maladroite !
Soudain, Gaspard bondit.
– Maman, tu as oublié mes bougies !
Jeanne sursaute, le couteau en l’air. Elle prend un air faussement contrit. Ses pensées actuelles sont si éloignées des bougies d’anniversaire de son fils ! Pourtant, pour les enfants, il faut donner le change, tenir bon, ne pas leur laisser croire que leur univers entier est susceptible de basculer d’un instant à l’autre. C’est son rôle de mère. Les protéger, les préserver du pire, quoi qu’il en coûte.
– Non, mon chéri, je n’ai pas oublié. J’ai préféré ne pas en mettre du tout, car je n’en avais que trois. Tu ne veux tout de même pas retourner à l’âge de trois ans ?
Apolline ricane.
– Bébé ! Tu as trois ans !
Gaspard lui tire la langue et fait mine de saisir l’une de ses nattes. La fillette se met à crier.
– Allons ! Ça suffit ! Votre mère a réussi à vous préparer un bon gâteau, c’est déjà un miracle par les temps qui courent, je ne veux pas d’histoires.
La grosse voix de leur père les ramène à la raison. Un silence plane au-dessus de la table, tandis que Jeanne et Henri échangent un regard lourd de sous-entendus. La main de Jeanne se remet à trembler. Jusqu’à quand vont-ils tenir ? Elle essaie de ne pas penser aux grosses valises dans l’entrée, pleines de toutes ces choses qu’elle accumule depuis quelques jours, « au cas où », ni aux vrombissements soudains des avions dans le ciel, de plus en plus nombreux, sans parler des rumeurs affolantes qui la maintiennent éveillée durant de longues heures chaque nuit.
Durant tout l’hiver, ils se sont pourtant crus à l’abri. Quelques dîners familiaux ont bien été perturbés par les récits des anciens, que l’ordre de mobilisation générale avait replongés dans l’horreur des tranchées, mais le quotidien de la famille Delaunay a été plutôt préservé jusqu’alors. Hormis la diffusion de circulaires contenant les instructions pratiques de la défense passive contre les attaques aériennes et un exercice de black-out grandeur nature, aucun changement significatif n’est venu troubler la vie des Armentiérois dans les mois qui ont suivi la déclaration de guerre de la France et de la Grande-Bretagne à l’Allemagne, après l’invasion de la Pologne. Aucun, sinon la présence de troupes anglaises et de canons dans la ville, et surtout l’absence des hommes qui, pour la plupart, avaient rejoint leur régiment à la fin du mois d’août 1939.
Henri a pu y échapper grâce à ses fonctions administratives locales. Étant commis de mairie à Armentières, sa présence a été jugée indispensable au bon fonctionnement de la ville, ce qui n’est pas au goût de certaines voisines jalouses, dont le mari, lui, a dû partir à la guerre. La première visite des gendarmes après la réception de lettres de dénonciations anonymes a fait frémir Jeanne, mais le livret militaire d’Henri étant en ordre, ils n’avaient rien à craindre. À la seconde visite, elle s’est contentée de hausser les épaules. On s’habitue à tout, ou presque.
Non, ce n’est pas vrai. On ne s’habitue pas à tout, et encore moins au climat de peur et d’affolement qui s’installe progressivement dans leur petite ville. Après les premiers échanges inquiets dans les files d’attente de plus en plus longues pour acheter son pain ou ses légumes, voilà que depuis quelque temps, Henri lui-même entend parler d’ordres inhabituels et de transferts de civils dans le cadre de son travail. Même si la censure militaire et gouvernementale fait en sorte de minimiser les retraites et les échecs, « pour le moral de la population », ils sentent qu’un danger imminent et sournois plane désormais au-dessus de leur tête en permanence.
Henri n’en a pas parlé tout de suite à Jeanne, non parce qu’il ne lui faisait pas confiance – son épouse est assez raisonnable pour ne pas s’affoler à la moindre mauvaise nouvelle, Dieu merci –, mais plutôt parce que lui-même ne savait qu’en penser. Néanmoins, leurs voisins directs étant équipés d’un poste de radio TSF, il leur arrive souvent maintenant, une fois les enfants couchés, de coller une oreille contre leur cloison mitoyenne et d’écouter les annonces militaires captées par les ondes, ainsi que les rares bulletins d’information clandestins. Il faut bien admettre que ceux-ci sont de plus en plus alarmistes.
Devant toutes ces incertitudes, c’est Jeanne elle-même, le mois dernier, qui a provoqué la tenue d’une sorte de conseil de famille. À l’issue de celui-ci, ils ont décidé qu’Henri passerait son permis de conduire et qu’ils utiliseraient leurs économies pour acheter une voiture d’occasion, toujours « au cas où »… Depuis, une vieille Peugeot 201 noire soulignée d’un fin liseré couleur crème a fait son apparition dans leur petit jardin, au grand dam des enfants qui, excités par cette présence impressionnante et incongrue dans leur univers quotidien, ont vu leur espace de jeu réduit au minimum.
Malgré tout, la confusion continue de régner. La montée en pression des commérages, alimentés par la peur et les nouvelles erratiques de la guerre, contraste étrangement avec les histoires rassurantes envoyées par les soldats aux familles depuis la ligne Maginot : ils lisent, jouent aux cartes, préparent des examens, bref… le front est si calme qu’au fond, ils s’ennuient ferme ! Et leurs proches commencent eux aussi à trouver le temps long. Que signifie donc cette drôle de guerre silencieuse, sans invasions et sans combats à mener ? Où se cache l’ennemi ? Il est tapi dans l’ombre, pour mieux bondir sur sa proie, Jeanne et Henri le comprennent, maintenant.
Leurs généraux français se sont montrés bien trop optimistes, voire orgueilleux, quant à l’efficacité de cette ligne de défense sur toute la frontière est du pays, poreuse comme un gruyère en réalité, puisqu’il suffit à quelques Boches bien avisés de contourner ses bunkers pour passer au travers ! Et comme ils ont la bonne idée de traverser en premier les Ardennes et la Belgique, les Armentiérois, dans le Nord, se trouvent désormais en première ligne !
Malgré un manque cruel d’informations officielles, la famille Delaunay prend peu à peu conscience de cette réalité. Jusqu’ici, les seules preuves tangibles du sérieux de ces menaces consistaient en une pénurie croissante de produits aussi élémentaires que le sucre, la viande ou le café. Mais, pas plus tard que dimanche dernier, les tirs de DCA[1] et les alertes ont été incessants, obligeant les habitants à se coucher tout habillés après avoir préparé le nécessaire pour descendre dans les abris en cas de danger.
Et maintenant que les premières files de réfugiés belges et hollandais traversent la frontière et commencent à affluer dans les rues d’Armentières, propageant dans le même temps des récits effroyables d’avancée allemande et d’infrastructures détruites, il faut se rendre à l’évidence : l’ennemi est aux portes de la France.
2
Armentières, 18 mai 1940
Les yeux brillants de gourmandise, Gaspard tend ses petites mains vers la part de gâteau qu’il convoite : la plus grosse, évidemment, même si la différence est si minime qu’il n’en est pas tout à fait sûr. C’est en tout cas celle qui est ornée de la plus belle tranche de pomme, dont sa mère s’est servie en guise de décoration. Il salive d’avance à l’idée de planter ses dents de lait dans la chair tendre et sucrée de ce fruit savoureux. Miam !
Ignorant le regard suspicieux d’Apolline, qui lorgne leurs deux parts comme pour en comparer le nombre de grains de cassonade, Gaspard saisit son assiette et s’apprête à entamer son gâteau d’un vigoureux coup de fourchette quand la voix douce de sa mère le stoppe net.
– Gaspard ! C’est peut-être ton anniversaire, mais n’en oublie pas tes bonnes manières, s’il te plaît. Attends que tout le monde soit servi avant de commencer.
Boudeur, le petit garçon se retient pour ne pas tirer les cheveux d’Apolline, qui pouffe bêtement à côté de lui. Elle peut se montrer si agaçante, parfois ! Si seulement il avait eu un grand frère, au lieu de cette sœur encombrante en robe à plis, qui préfère admirer le nœud de ses nattes voltiger dans son dos plutôt que de gagner la course !
Ses parents louent sans cesse sa sagesse, mais c’est parce qu’ils la connaissent moins bien que lui ! Dès qu’ils ont le dos tourné, elle ne se prive pas de leur désobéir et de lui répéter les gros mots qu’elle entend dans la cour, quand le voisin s’énerve contre sa femme. Au lieu de l’inciter à se boucher les oreilles, comme le leur recommande leur mère, elle lui fait : « Chut ! » en fronçant les sourcils, et elle essaie de comprendre pourquoi ils se fâchent. Qu’est-ce que ça peut bien lui faire ? Gaspard ne comprend pas la raison de cette curiosité qui le met un peu mal à l’aise, mais, puisqu’Apolline est la plus grande, il obtempère, au moins pour ça. Et puis, il n’est pas un cafteur.
Jeanne découpe pour elle la dernière part, la plus petite, et se rassied en levant enfin les yeux vers son fils, qui tient toujours sa fourchette en l’air, au garde-à-vous, prêt à se jeter sur ce petit morceau de paradis. Cela fait au moins deux mois qu’elle ne leur a pas servi une « petite douceur », comme elle dit, et, pour une famille de gourmands comme la leur, les premières privations sont rudes. Elle parvient encore à leur confectionner de temps en temps des Ponts de la Deûle avec la crème du lait qu’elle fait bouillir, et qu’ils trempent dans leur bol de chicorée pour les faire ramollir, mais bientôt, même ces petits biscuits dont ils raffolent ne seront plus qu’un lointain souvenir. Les œufs, le beurre et le sucre sont devenus si chers, ces derniers temps, et leur approvisionnement est si aléatoire, que Jeanne préfère les réserver aux grandes occasions, comme aujourd’hui, pour les cinq ans de son petit garçon. Déjà !
Elle se souvient du jour de sa naissance comme si c’était hier. Les premières douleurs étaient survenues à l’aube, dans la blancheur d’un petit matin annonciateur de promesses. En tout cas, c’est ce dont elle essayait de se persuader pour conjurer le sort. Deux ans avant la naissance d’Apolline, Jeanne avait perdu son premier enfant, trois jours à peine après son accouchement. C’était une petite fille, malheureusement atteinte de la « maladie bleue »[2], qui n’avait pas survécu.
Jeanne ne s’en est jamais vraiment remise. Dix ans après, elle revoit le visage grave de la sage-femme penché sur le petit corps de Marguerite comme si c’était hier, son stéthoscope en bois serré entre ses doigts, ses mains douces aux paumes larges qui sentaient le savon de Marseille. Elle s’était tout de suite inquiétée de la coloration de l’enfant. Jeanne elle-même l’avait remarquée quand on lui avait posé la petite sur la poitrine, mais, comme c’était son premier bébé, elle s’était dit que c’était peut-être normal, ces lèvres blanches, ce teint si pâle qu’il tirait sur le gris. Marguerite venait tout juste de naître et avait fourni un gros effort, il fallait attendre un peu, une fois qu’elle arriverait à prendre le sein, elle aussi allait se mettre à rosir et à grossir comme les autres. Mais la petite fille n’y était jamais parvenue.
La sage-femme l’avait pourtant mise en garde au cours des heures ayant suivi la naissance, mais Jeanne avait voulu y croire jusqu’au bout. Elle revoit les yeux inquiets de la professionnelle, elle sent ses mains sur les siennes, elle entend ses paroles prononcées d’une voix douce, mais sans appel. « Jeanne… il faut que je vous parle de la petite. » Elle avait redressé la tête sur ses oreillers, inquiète. « Elle va bien, n’est-ce pas ? Je l’ai entendue crier… » « Elle respire, mais pas comme il faudrait. Vous avez vu le bleu autour de sa bouche ? » Jeanne avait hoché la tête en tremblant. Elle ne se sentait pas prête à écouter la suite, mais avait-elle le choix ? La sage-femme avait poursuivi ses explications en chuchotant, comme si cela pouvait atténuer la violence de ses propos. Elle savait d’expérience qu’il valait mieux prévenir tout de suite la jeune accouchée, ne pas lui laisser le temps de trop s’attacher à son bébé… « C’est un défaut du cœur. La maladie bleue. Certains tiennent plus longtemps que d’autres, mais… » Jeanne avait pâli et porté la main à sa bouche. « On peut certainement faire quelque chose ? Pourquoi n’appelez-vous pas un médecin ? » La sage-femme avait planté son regard bleu dans le sien. « Je vais le faire. Mais il ne pourra pas la sauver. Il faut vous préparer. »
À partir de là, Jeanne avait basculé de l’autre côté du miroir, dans un monde où le plus beau jour de sa vie pouvait aussi devenir le pire. Un monde terrifiant, empli d’ombres et de la peur viscérale, inhumaine, de perdre l’être auquel elle tenait pourtant plus qu’à sa propre vie. Comment était-ce possible ?
Henri était apparu à ses côtés, la mine désolée. Il s’était assis sur le rebord du lit et Jeanne avait détourné la tête pour fuir l’expression de ses grands yeux tristes. Son chagrin à elle prenait déjà toute la place, elle ne pouvait pas s’encombrer en plus du sien. Elle avait prétexté des douleurs et la nécessité d’accomplir des soins intimes pour qu’il reflue vers le salon et tienne le rôle qui deviendrait le sien pour de longues semaines : faire barrage entre elle et le monde. Elle ne voulait plus voir personne. Pouvait-on lui rendre sa petite Marguerite ? Non. Plus rien d’autre ne l’intéressait.
Cette période terrible marqua le premier éloignement visible entre elle et Henri, du moins, le premier dont elle eut pleinement conscience. Leur bébé étant né et décédé dans cette même chambre où il avait été conçu, Jeanne associait le lit conjugal à un endroit sacré, sinon maudit, et refusait d’y dormir à nouveau avec son mari. Compréhensif, Henri avait accepté de migrer dans la pièce voisine, celle que les enfants occupent désormais, et avait patienté de longs mois avant de pouvoir réintégrer la chambre parentale. Néanmoins, même si, en apparence, il avait retrouvé sa femme, plus rien n’était comme avant.
Deux ans plus tard, lorsque Jeanne était tombée enceinte d’Apolline, elle avait tout fait pour ne pas reporter sur ce bébé les angoisses de mort qu’elle associait forcément à une nouvelle naissance, mais ce n’est qu’aux trois mois d’Apolline qu’elle avait commencé à souffler. Sa petite fille était bien rose et tétait goulûment au point que de nombreux petits plis commençaient à se former dans son cou et sur ses cuisses… Ils en plaisantaient avec Henri, ce qui leur permettait de masquer le désarroi qui s’emparait parfois d’eux lorsqu’ils comparaient l’insolente santé de cette enfant à celle de leur fille aînée aux joues grises et aux lèvres bleues, âgée de trois jours pour l’éternité.
Ensuite, le joyeux petit Gaspard était arrivé dans leur vie, sans tambour ni trompette. Prise dans le tourbillon de sa première maternité, Jeanne s’était rendu compte de sa grossesse assez tardivement, aussi n’a-t-elle presque pas eu le temps d’avoir peur. Et puis, Apolline était la preuve vivante qu’ils étaient capables de fabriquer un beau nouveau-né en pleine forme. Le miracle se reproduisit donc, et le petit fantôme de Marguerite, s’il continuait de les hanter, devint un peu moins obsédant, en apparence tout au moins.
Jeanne et Henri n’en parlaient jamais. Cela faisait partie des grands chagrins silencieux, de ceux qui prennent toute la place sans qu’il soit besoin de les nommer. Comme une évidence. Une blessure souterraine qui creusait son lit en toute discrétion.
Pourtant, encore aujourd’hui, pas un jour ne passe sans que Jeanne imagine le visage qu’aurait aujourd’hui sa petite Marguerite, les éclats de sa voix, de son rire, son caractère… Elle aurait dû fêter ses neuf ans cette année. Nul doute qu’elle l’aurait aidée à préparer le gâteau de Gaspard et qu’elle aurait houspillé son frère et sa sœur pour qu’ils cessent de se disputer. Il faut dire que ces deux-là sont vraiment comme chien et chat…
Un voile passe dans les yeux de Jeanne. Elle contemple les cheveux blonds de ses enfants, leurs mines gourmandes et espiègles, et remercie le Ciel en son for intérieur de lui avoir accordé ces deux-là. S’il le fallait, elle donnerait sa vie pour eux, sans hésiter.
– Joyeux anniversaire, mon cher petit garçon, murmure-t-elle.
Henri lève son verre de jus de pommes pour trinquer à son tour à la santé de leur fils, quand un fracas sur la porte d’entrée les fait tous sursauter. Les mains de Jeanne se remettent aussitôt à trembler.
Qui peut bien tambouriner aussi fort chez eux en plein après-midi ?
3
Armentières, 18 mai 1940
Henri se lève le premier en ordonnant à Jeanne et aux enfants de ne pas bouger.
– Restez ici. Je vais voir.
Les coups continuent de pleuvoir sur la porte. Apolline et Gaspard écarquillent les yeux, cherchant une explication sur le visage de leur mère, mais celle-ci semble s’être figée en une statue de sel. Apolline chuchote.
– Tu crois que c’est les Allemands, maman ?
À ces mots, Jeanne sort de sa torpeur et jette sa serviette sur la table en foudroyant sa fille du regard.
– Ne dis pas de bêtises ! Tais-toi !
Les yeux d’Apolline se remplissent de larmes. La dernière fois que sa mère lui a parlé aussi durement, c’était pour la réprimander d’avoir utilisé les draps propres en train de sécher dans la cour pour s’en faire des capes de princesse… Emportée dans son jeu, elle n’avait pas vu les traces de boue qui obligeraient sa mère à tout relaver, ce qui signifiait des heures de travail pour rien. Oui, cette engueulade-là, elle ne l’avait pas volée.
Mais, cette fois-ci, qu’a-t-elle dit de mal ? C’est pourtant la vérité, pas plus tard qu’hier, à l’école, son amie Colette lui a répété : « Mon papa dit que les Boches reviennent ! », et, depuis quelque temps, ils font des tas de nouveaux exercices avec ses petits camarades. Mademoiselle Irène, leur institutrice, essaie de rendre cela amusant quand elle leur explique comment fermer les volets de la classe et descendre à la cave le plus rapidement possible, sans bousculade, mais les enfants perçoivent bien que tout cela n’a rien d’un jeu habituel.
La première fois que le concierge a agité la cloche en plein milieu de la matinée, ils se sont tous regardés avec un air effaré : avait-il perdu la tête ? Mais la maîtresse avait aussitôt tapé dans ses mains en leur ordonnant de se mettre en rang deux par deux, comme si tout était normal. Ils ont traversé le couloir en direction de la porte du fond, celle qui donne sur l’escalier menant à la cave de l’école, où aucun d’entre eux n’avait jusque-là mis les pieds. Les petits élèves étaient alors descendus le long des marches l’un après l’autre, le cœur battant, pour se retrouver dans une grande pièce voûtée aux murs de briques qui sentait la terre humide et la poussière de charbon.
Tandis que des petits malins profitaient de la semi-obscurité pour effrayer leurs camarades, Mademoiselle Irène avait à nouveau tapé dans ses mains pour enjoindre à ses élèves de s’assoir sur les bancs de bois disposés à cet effet le long des murs. Dociles et habitués à obtempérer sans poser de questions, les enfants s’étaient exécutés. Apolline avait aussitôt détesté cet endroit. Contrairement à la cave de sa propre maison, qui sent bon les épices et que la présence de cageots de pommes de terre et de sacs de farine rend inexplicablement rassurante, celle-ci ressemblait juste à un vieux cachot oublié.
Cela dit, après ce premier exercice étrange, les élèves de la petite école primaire ont fini par s’habituer aux interruptions intempestives de leurs leçons par le son métallique de la cloche du concierge. Lorsqu’elle retentit, ils se faufilent en rangs serrés jusqu’à la vieille cave humide et sombre, et Colette et Apolline veillent bien à rester ensemble au moment de descendre l’escalier, pour ne pas être séparées sur le banc où elles viennent s’assoir, toujours à la même place. Au bout de cinq minutes à peine, de petites voix impatientes ne manquent jamais de s’élever dans la pénombre : « C’est bientôt fini, maîtresse ? » Mademoiselle Irène leur demande alors de réciter une comptine qu’elle vient de leur apprendre, et le temps passe plus vite. Ils en finissent souvent par oublier pourquoi ils se retrouvent entassés là et s’amusent des traces de charbon que les murs noircis laissent sur leurs bras nus ou sur leurs vêtements quand ils reviennent à la lumière, au grand dam de leurs mères.
À la maison aussi, l’atmosphère a changé. Apolline entend ses parents parler à voix basse entre eux, et capte des mots nouveaux et mystérieux, tels que « invasion », « combat », « évacuation »… Une fois qu’elle et Gaspard sont couchés, le soir, elle prétexte un besoin d’aller aux toilettes ou une soif soudaine pour descendre l’escalier de bois en catimini et surprendre leurs conversations inquiètes qui cessent dès qu’elle apparait dans leur champ de vision.
Cependant, au-delà de tous ces signaux d’alerte, le plus fort de tous reste cette angoisse sourde que la fillette pressent chez sa mère sans pouvoir la nommer.
Car Jeanne a peur. Pas pour elle, non. Mais elle connaît le prix de la perte. Et la perspective de vivre ce risque encore une fois la terrasse.
Interloqué par la réaction de sa mère, Gaspard en oublie de porter sa fourchette à sa bouche, et tend l’oreille vers l’entrée. Les coups sur la porte ont cessé, remplacés par des éclats de voix qu’ils perçoivent nettement entre Alphonse, leur voisin colérique, et leur père.
– Faut partir ! Restez pas là, nom d’un chien, c’est dangereux !
Gaspard a beau avoir l’ouïe fine, il n’entend pas la réponse de son père. Après quelques secondes, la grosse voix d’Alphonse leur parvient à nouveau, rocailleuse et pressante.
– Ils arrivent, j’vous dis ! Avec Yvonne on prend la charrette et on fout l’camp ! Puisque vous avez une voiture, emmenez donc vot’ dame et vos gamins loin d’ici ! Y sont tout près, bon sang ! Paraît qu’leurs blindés viennent tout juste de franchir la Sambre !
Apolline et Gaspard échangent un regard inquiet, plus perturbés par la terreur qu’ils lisent dans les yeux de leur mère que par les mots du vieil Alphonse. De toute façon, il crie tout le temps celui-là, alors un peu plus ou un peu moins…
– C’est qui qu’arrive, m’man ? murmure Gaspard.
– On dit : « Qui est-ce qui arrive ? », le reprend Apolline.
Elle adore jouer à l’institutrice avec ses trois poupées et sa baguette en merisier en imitant le ton de Mademoiselle Irène. Son petit frère ferait un élève idéal, mais elle n’a jamais réussi à le convaincre d’assister à ses leçons, qu’il trouve bien trop enquiquinantes. Tant pis pour lui ! Cette fois-ci pourtant, au lieu de lui tirer la langue ou de hausser les épaules, il répète sagement après elle : « Qui est-ce qui arrive, maman ? »
Mais leur mère ne semble pas les entendre. Pétrifiée, elle essuie ses mains sur son tablier et se lève si précipitamment qu’elle en fait tomber sa chaise à la renverse. Leur petit Mitsou, qui patientait sous la table en espérant un reste de beurre ou de crème à laper, s’enfuit en courant, les oreilles en arrière.
Au même moment, Henri surgit dans la cuisine, la mine grave, le souffle court.
– On doit partir. Maintenant.
Puis, il repart dans l’entrée à grands pas, enfile sa veste et attrape les deux grosses valises auxquelles Gaspard et Apolline avaient fini par ne plus prêter attention.
– Allez chercher vos manteaux, les enfants, claironne Jeanne sur une voix qu’elle voudrait assurée, mais qui tremble encore plus fort que ses mains.
– Mais… et mon gâteau ? proteste Gaspard. Mon anniversaire ?
– On le fêtera plus tard, mon chéri. Je te le promets. Allez, dépêchez-vous !
Les yeux du petit garçon s’embuent. Ce gâteau aux pommes dont il rêvait, on ne peut pas l’en priver comme ça, au tout dernier moment, alors que les effluves sucrés de la cuisson flottent encore dans la maison ! Mais sans lui laisser le temps de protester, sa mère ramasse les quatre assiettes et en verse le contenu dans le seau à ordures. Son précieux quartier de pomme ! Il avait eu la plus grosse part, en plus ! Des larmes silencieuses inondent ses joues tandis qu’autour de lui, c’est l’effervescence. Peu importe. En cet instant précis, alors que sa sœur court dans leur chambre pour récupérer sa poupée préférée et que ses parents s’affolent en fermant la maison à la hâte, rien ne compte plus au monde pour Gaspard que son gâteau d’anniversaire perdu. Et Mitsou.
Il cesse alors de pleurer pour se mettre à crier.
– Maman ! Papa ! Où est Mitsou ? On peut pas partir sans lui !
Ce chat noir et blanc fait partie de la famille, Gaspard l’a toujours connu, il est hors de question de l’abandonner ! Mais ses parents ne l’écoutent pas. Ils passent et repassent devant lui, les bras chargés d’affaires, comme si Apolline et lui étaient soudain devenus transparents. Ce n’est qu’au moment de les faire monter dans la voiture qu’ils semblent enfin l’entendre. Il faut dire que Gaspard hurle et s’arcboute maintenant, il refuse de partir sans son petit chat chéri, ce compagnon de jeu qui les suit jusqu’à l’école le matin, et qui guette leur retour le soir, assis bien droit en haut du mur de briques rouges d’Alphonse et Yvonne.
– Non ! Non ! crie Gaspard. Je partirai pas sans lui !
– Ça suffit ! Ce n’est qu’un chat, il chassera toutes les souris du quartier en nous attendant, et tu verras comme il sera bien gras quand on reviendra !
Les paroles de son père glissent sur lui sans l’atteindre. Mitsou n’a jamais chassé les souris, il devrait pourtant le savoir ! C’est le plus gentil des petits chats que Gaspard connaisse, et ce départ-là, même si ses parents ne lui en disent pas grand-chose, n’a rien à voir avec leurs rares visites aux grands-parents ou autres escapades en Belgique au retour desquelles Mitsou leur fait toujours la fête ! Qui sait, même, s’ils reviendront un jour ? À voir la mine catastrophée de maman, rien n’est moins sûr !
Gaspard échappe aux mains dures de son père, qui tente de le contraindre à monter dans la voiture et se faufile comme une anguille jusqu’au portail. Il grimpe alors sur le mur à l’aide d’une encoche qu’il connaît par cœur afin d’avoir une vue circulaire sur le jardin et la rue en criant le nom de son chat, mais une fois arrivé en haut, ses mots se bloquent dans sa gorge.
– Mits…
Le petit garçon contemple, effaré, le spectacle désordonné qui s’offre à son regard. La rue, habituellement si calme, est littéralement envahie par une foule dense et hétéroclite, à pied, à cheval, en vélo… Comme si leur petite ville tranquille avait soudain basculé dans le chaos. Gaspard n’a jamais vu autant de monde rassemblé au même endroit au même moment, à part peut-être à Lille certains jours de marché, ou pendant la ducasse[3] sur la Grand-Place d’Armentières, quand sa mère les emmène, sa sœur et lui, manger des gaufres ou admirer les stands de tir au son des fanfares et des accordéons.
Abasourdi, il redescend du mur en prenant garde de ne pas déchirer la jolie chemisette blanche que sa mère réserve aux grandes occasions, et comprend vaguement que ce qui leur arrive est peut-être encore plus grave que l’abandon de Mitsou.
4
Armentières, 18 mai 1940
Les mains serrées sur ses genoux, le regard perdu au-delà de la foule, Jeanne tente de rassembler ses esprits. Depuis qu’ils ont quitté la maison, son cerveau tourne à vide, comme si ses pensées s’enfuyaient loin devant elle. Elle est choquée, sidérée par ce départ si brutal qu’une partie d’elle refuse encore à y croire. Cela ne peut pas être vrai. Ils vont faire le tour du quartier, à la limite sortir de la ville et revenir avant la nuit tombée. Elle tente de se persuader qu’il s’agit là d’un simple exercice, comme ceux que les enfants font à l’école tous les matins à la demande de la défense passive, pour simuler la conduite à tenir en cas d’attaque aérienne. Tout comme les recommandations de ne pas allumer les lumières la nuit ou d’obscurcir les fenêtres, il ne s’agit certainement que de précautions, de mesures prises « au cas où »…
Tout cela, au fond, personne ne veut vraiment y croire, et encore moins les anciens. Eux, qui ont vécu l’horreur absolue pendant quatre années d’enfer sous le feu ennemi, ne peuvent même pas concevoir que des événements similaires à ceux qui ont décimé leur jeunesse se reproduisent aujourd’hui. L’homme peut-il être devenu fou à ce point ?
Jeanne avait huit ans quand son père est revenu de la Grande Guerre, en 1918. Il avait été appelé auprès d’un régiment d’infanterie dans le secteur d’Ypres dès le mois d’août 1914, et les brèves permissions qu’il obtenait de loin en loin ne suffisaient pas pour nouer avec sa fille des liens dignes de ce nom. Ce père lointain et éreinté, qui faisait de fugaces apparitions dans sa vie d’enfant et dont sa mère parlait avec des accents d’angoisse dans la voix, Jeanne n’a réellement fait sa connaissance qu’après son retour, en novembre 1918. Avec le recul, elle se souvient surtout d’une ombre apathique et silencieuse, maigre à faire peur, qui la croisait sans la voir dans les couloirs de sa maison d’enfance. Il ne fallait pas crier ni rire, ni même parler, tout juste chuchoter. Et respirer ? Oui, ça, on pouvait, mais pas trop fort. On avait à peine le droit de vivre, soupire Jeanne en repensant à ces tristes années. Alors, elle jouait en cachette avec sa sœur, et lisait jusqu’à l’écœurement. C’est dans ces années-là qu’elle a découvert les collections de la Bibliothèque rose et de la Bibliothèque verte, La Comtesse de Ségur, Jules Vernes, ou encore les revues de La Semaine de Suzette avec Bécassine, dont les mésaventures la faisaient pleurer de rire… en silence.
« Chut ! Ton père se repose, il ne faut pas faire de bruit ! » Combien de fois sa mère l’a-t-elle réprimandée, un doigt posé sur la bouche, lui intimant de rester aussi discrète qu’une petite souris. Elle a intégré cet impératif au point parfois de se faire oublier. Aujourd’hui encore, elle reste marquée par cette injonction de respect, de déférence, presque de sacrifice de son propre bonheur pour ne pas déranger l’ordre établi, alors représenté par ce père miraculeusement revenu d’une guerre effroyable, mais fracassé par ce qu’il y avait vu et vécu.
Petite, Jeanne savait que son papa n’avait pas toujours été ce fantôme taciturne qu’il ne fallait pas déranger. Grâce à des hommes moins taiseux que lui, elle avait compris qu’il avait vécu des choses terribles, des choses qui le faisaient crier en pleine nuit et qu’elle essayait de ne pas entendre en enfouissant la tête au creux de son oreiller. Elle enviait alors sa sœur, qui ronflait comme une bienheureuse à côté d’elle, et priait pour que son papa se rendorme vite. Le lendemain, elle évitait de le regarder dans les yeux en effleurant sa joue râpeuse du bout des lèvres, pour ne pas voir ce regard vide et triste qui lui faisait si peur.
Oui, à seulement huit ans, Jeanne avait déjà compris que ceux qu’on appelait alors « les gueules cassées », autrement dit les hommes défigurés au combat, n’étaient pas les seuls à avoir souffert à mort de cette guerre. D’autres blessures, plus sournoises, rampantes, invisibles à l’œil nu, pouvaient aussi détruire les foyers.
Alors, aujourd’hui, envisager de vivre une fois encore cet enfer, exposer les hommes aimés, les maris, les fils chéris, les frères à cette machine à broyer les âmes semble tout simplement inconcevable.
Bien à l’abri dans l’habitacle de la vieille Peugeot qui sent l’essence et le cuir fatigué, Jeanne ne se formule pas clairement son aversion pour la guerre et ses enjeux qui la dépassent, et, lorsqu’Henri engage la voiture dans leur rue transformée en marée humaine, elle ne pense pas non plus aux anciens traumatismes de son père. Mais la panique qu’elle ressent à l’idée de quitter sa maison, son abri, le refuge où ses enfants ont grandi la prend à la gorge aussi sûrement que si un Boche la menaçait de son arme, là, juste devant elle.
Un instant distraite par les reniflements de Gaspard, elle essaie de ne pas penser à leur petit Mitsou. Comment peut-elle se préoccuper d’un chat alors que la ville entière est sens dessus dessous ? Elle aimerait qu’Henri la rassure, l’aide à remettre de l’ordre dans ses idées, mais il est concentré sur la route, les sourcils froncés, l’œil dur et lointain. Venant tout juste d’obtenir son permis, il aurait sûrement préféré s’exercer à la conduite en d’autres circonstances, mais elle l’envie presque de pouvoir canaliser son stress sur ses gestes. Rapidement, cependant, sa propre attention est happée par ce qui se passe à l’extérieur. Tout comme les enfants, elle colle son nez à la vitre et tente de reconnaître des gens de son entourage, à défaut de pouvoir mettre du sens sur tout cela.
Peine perdue. Il lui semble qu’une horde d’étrangers vient de se déverser dans la rue, sa rue, et que les familles ont entassé à la va-vite, sans aucun sens pratique, tout ce qui leur tombait sous la main au moment du départ. Les voitures sont rares, et, en cela, Jeanne sait qu’ils sont privilégiés. Hormis les difficultés d’approvisionnement en essence, ce véhicule confortable leur permettra de s’éloigner bien plus rapidement des sites dangereux que tous ces gens en charrette, à vélo ou à pied. Ce pauvre vieux, là, qui pousse devant lui une brouette chargée jusqu’à la gueule, arrivera-t-il seulement à sortir de la ville ?
– Oh ! Regarde, maman !
La voix claire d’Apolline attire son attention vers un attelage étonnant : deux petits ânes, si chargés qu’ils zigzaguent, trottinent à côté des chevaux. Gaspard en oublie de chouiner. Il traque avec sa sœur les poules, chiens, cages à oiseaux et autres casseroles qui dégringolent des charrettes où s’entasse la vie des gens. Eux-mêmes ont été jusqu’à sangler un matelas sur le toit de leur voiture, comme des bohémiens ! Mais qui sait où ils dormiront ce soir, et les suivants ? Jeanne frémit. Ne pas y penser. Un jour à la fois. L’urgence, pour l’heure, est de mettre leur famille à l’abri.
Les plus jeunes pédalent comme des damnés sur leur vélo, et Jeanne se demande bien ce qui leur prend à vouloir dépasser tout le monde comme s’ils avaient le diable à leurs trousses ! Cela dit, eux, au moins, ils avancent. C’est loin d’être leur cas. Par la vitre entrouverte, ils perçoivent le bruit étouffé des pas, le cliquetis d’objets mal attachés, les roues qui grincent, les pleurs d’enfants, les cris de tous ces gens qui ont l’air aussi perdus qu’eux.
C’est la débâcle. Une forme de fin du monde, d’arrachement. De fuite en avant vers un univers informe et inconnu, dangereux. Incertain.
La dernière fois que Jeanne a connu pareille angoisse, c’était après l’annonce de la sage-femme qui l’avait aidée à mettre au monde Marguerite. La petite était encore bien vivante, mais une menace sourde et terrible s’était alors mise à peser sur elle, comme si une mauvaise fée s’était penchée sur son berceau, la condamnant à jamais.
Cette fois-ci, c’est un mauvais génie en forme de croix gammée qui s’apprête à dévaster leur univers. Comment s’en préserver ? Jeanne veut bien donner tout ce qu’elle a pour protéger la vie des siens, mais elle n’a rien pu faire pour Marguerite, alors quel Dieu pourra bien les défendre contre ce qui est en train d’arriver ?
5
Armentières, 18 mai 1940
– Henri, on ne sait même pas où on va !
– Pour l’instant, il faut juste essayer de sortir de la ville, tu vois bien qu’on est coincés ! Regarde-moi cette foire, faudrait pas qu’ils aient la bonne idée de balancer une bombe maintenant au milieu de la foule. Ça ferait un beau carnage…
– Ils ne tireraient quand même pas sur des civils ! Et puis, mesure tes paroles, s’il te plaît…
Jeanne lance un coup d’œil furtif vers la banquette arrière. Leurs enfants, habituellement si réactifs et prompts à se chamailler, sont mutiques depuis qu’ils ont quitté la maison. Entre l’expérience extravagante de circuler en voiture et le spectacle indescriptible des rues d’Armentières sens dessus dessous, sans compter l’abandon traumatisant de leur petit chat, Apolline et Gaspard se font oublier. Leur mère n’est pas dupe pour autant : même s’ils n’en montrent rien, elle sait qu’ils ne manquent pas une occasion d’écouter aux portes pour tenter de comprendre le chaos qui bouleverse le monde des « grands » en ce moment. Suivant le modèle de sa propre mère, qui faisait tout pour la tenir à l’écart des nouvelles de la guerre quand elle était petite, Jeanne essaie tant bien que mal de rassurer ses enfants.
– Nous reviendrons vite à la maison, et tout rentrera dans l’ordre.
Henri hausse les épaules. Il ne comprendra jamais cette obstination de sa femme à faire comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes, même quand tout s’effondre autour d’elle. Il connaît pourtant son intelligence et sa lucidité, mais, dès lors qu’il s’agit des enfants, on dirait que ce n’est plus la même personne. Si elle pouvait les mettre sous cloche pour être sûre qu’il ne leur arrive rien, elle le ferait… Ce n’est pourtant pas ainsi qu’on élève des gosses ! Lui-même, à quatorze ans, a bien dû renoncer à ses études pour travailler et ramener de l’argent à sa mère… Depuis le décès du père, survenu lors de la bataille du Chemin des Dames en 1917, elle ne s’en sortait pas avec ses quatre enfants, et Henri étant l’aîné, elle l’a vite poussé dehors, malgré ses aptitudes à l’école. Il aurait pourtant rêvé d’être architecte. Dans une autre vie, peut-être… Cela dit, heureusement que ses parents ne sont plus de ce monde pour voir tout ce qui arrive en ce moment… Ils doivent se retourner dans leur tombe, à coup sûr.
Henri s’est bien gardé de le dire à Jeanne, mais ce midi, quand il est rentré déjeuner à la maison pour fêter l’anniversaire de Gaspard – quelle idée, ça aussi, franchement ! comme si c’était le moment ! –, il a échangé quelques mots sur la route avec des évacués belges qui, la peur agrandissant leurs yeux, lui ont raconté comment les avions mitraillaient les routes et abattaient sans pitié les colonnes de réfugiés à pied ou en charrette, tuant sans distinction les hommes, les femmes, les enfants et les vieillards. « Même les bébés ! » avait sangloté une jeune fille aux yeux sombres, et ils avaient tracé leur route en lui conseillant de fuir au plus vite.
Quand il avait franchi le pas de la porte et senti les odeurs de gâteau dans la maison, Henri n’avait pas eu le cœur de jouer les trouble-fêtes. Il avait juste prévenu Jeanne que les rues grouillaient de monde et que le réservoir à essence était plein, « au cas où ». Mais l’intrusion d’Alphonse avait fini de le décider, tout comme le spectacle désolant de la foule qui s’amassait jusque devant chez eux, sans compter la cohue qui régnait à la gare, où se déversaient sans discontinuer des trains bondés en provenance de Lille. La panique était contagieuse.
Lorsqu’il a donné le signal du départ, contraint et forcé, il s’est senti acculé, poussé en avant par une force indescriptible, un engrenage aussi massif et inéluctable qu’un fleuve en crue. C’est encore l’impression qu’il ressent en ce moment même, au volant de cette Peugeot qu’il maîtrise si mal. Il a appris à conduire sur des routes de campagne isolées, et voilà qu’il se retrouve pris dans une nasse brouillonne et informe, la peur au ventre à l’idée de caler au mauvais moment ou de renverser un enfant. Il sent ses pieds glisser sur les pédales dures et imprécises de la vieille voiture, ses mains se crisper sur ce grand volant fin, et il redoute plus que tout de ne pas avoir les bons réflexes au bon moment. Que se passera-t-il si les prédictions de ces réfugiés belges s’avèrent exactes ? Saura-t-il protéger les siens de tirs venus du ciel, lui qui n’a même pas été foutu d’aller au front ?
Il sait que Jeanne se réjouit de ce qu’il n’ait pas été appelé et, pendant un temps, lui aussi s’est senti soulagé à cette idée. Tout valait mieux plutôt que crever comme son père sous le feu ennemi, non ? Pour ce qu’on y gagnait… Mais, voilà. Les mois passant, il avait de plus en plus de mal à supporter les regards en coin des voisines, des promeneurs, des employés et parfois même des enfants qui semblaient tous se demander ce qu’il fichait encore là, lui, jeune et en pleine possession de ses moyens, pendant que d’autres risquaient de se faire trouer la peau pour défendre les intérêts de la nation. S’agissait-il d’un planqué ? D’un pleutre, ou pire, d’un traître ?
Peut-être imaginait-il ces jugements, ces remises en question de son rôle d’homme et de père dans la société, mais toutes ces lettres anonymes, bon sang, il ne les inventait pas ! Il en rêvait parfois, la nuit. Tout ça le mettait profondément mal à l’aise, surtout quand il croisait des soldats anglais dans les quartiers d’Armentières, fiers de parader en uniforme devant les jeunes filles françaises. Il se sentait minable, alors, dans son sage costume gris, son porte-documents sous le bras, pour aller tamponner des certificats de naissance et enregistrer des demandes d’allocations pour les familles mobilisées.
La tentation était grande de s’en prendre aux enfants quand il rentrait le soir, mais il résistait. Même si leurs cris et leurs chamailleries lui portaient sur les nerfs, il devait reconnaître qu’ils n’y étaient pour rien dans sa situation ambiguë. Les autres pères de famille étaient bien partis, eux. Non, c’était plutôt Jeanne à qui il en voulait. Cela n’était pas forcément plus juste, mais puisqu’elle était si heureuse de le savoir en sécurité et de profiter de sa présence parmi eux au lieu de devoir faire face toute seule aux aléas de la guerre, comme les autres femmes de son entourage, il la rendait un peu responsable de son mal-être.
Qui sait si, sans cela, il n’aurait pas insisté pour partir malgré tout ? Et puis, il avait tant souffert de son rejet au décès de leur petite Marguerite, lorsqu’il avait dû affronter tout seul sa douleur dans ce lit aux draps glacés pendant que Jeanne se morfondait de son côté… Même s’il ne lui reproche pas consciemment ces mois de désert affectif à un moment de sa vie où il se sentait aussi désemparé qu’elle, ils ont existé. Et Henri ne peut pas s’empêcher de penser qu’en cas de coup dur, vraiment dur, il se retrouvera seul, encore une fois.
Pourtant, il n’avait pas réfléchi très longtemps avant de la demander en mariage. Il était tombé tout de suite sous le charme de cette jeune brune aux yeux clairs, dans une région où la plupart des filles sont blondes, et il avait été particulièrement séduit, outre sa nuque gracile et ses épaules bien droites, par la profondeur de son regard. Oui, Jeanne respirait l’intelligence, et, pour Henri, qui avait été privé d’école, ça comptait. Dès leurs premières paroles échangées, il avait su que cette fille était « la bonne », celle qu’il pouvait envisager d’épouser.
Il a encore du mal à se l’expliquer, surtout après tout ce qu’ils ont traversé, mais quelque chose en elle l’a bouleversé. Aujourd’hui, il a la nostalgie de ces jours bénis où seules comptaient les heures qu’il passait auprès d’elle, où il rêvait de l’embrasser, de défaire son chignon et les premiers boutons de son corsage… Ces heures où tout était encore possible, où leur vie était à inventer.
Leurs premières étreintes n’ont pas été aussi magiques que ce qu’il espérait. De cela non plus, ils n’ont jamais parlé. Est-ce que ça vient de leur éducation, de la pudeur de Jeanne, de la sienne ? Toujours est-il qu’il n’a quasiment jamais vu sa femme nue « en entier », seulement par petits bouts, et que leurs câlins dans le noir ont toujours été si rapides, presque chastes, qu’Henri a fini par se dire que cela devait se passer ainsi entre tous les maris et femmes… Pourtant, il aurait rêvé de la voir s’abandonner à ses caresses et y prendre du plaisir, mais, depuis le décès de Marguerite, il s’estime juste heureux de pouvoir encore approcher Jeanne de temps en temps.
Aussi loin qu’il s’en souvienne, elle n’a jamais manifesté d’intérêt pour l’amour physique. Au moment de leurs premiers rapprochements, elle se contentait de se laisser embrasser, toucher, désirer, mais sans initier le moindre geste envers lui, comme si les sphères du désir lui demeuraient inconnues. Il a eu beau prendre sa main, l’inciter à découvrir son anatomie, la laisser venir… Jeanne se contentait de sourire, rougissante, avant d’éteindre la lumière en baissant pudiquement les paupières. Il en a pris son parti, et, avec les années, il n’imagine même plus que les choses pourraient se passer autrement.
De son côté, il a nourri quelques fantasmes avant de rencontrer sa femme, qui reviennent le hanter lors de leurs longues périodes chastes, mais il ne lui a jamais été infidèle. À la fin de son adolescence, quand il était garçon de salle à la Brasserie Breuvard, la serveuse Berthe, bien plus âgée que lui, le laissait parfois toucher sa poitrine dans l’arrière-salle, entre deux fûts de bière… Elle le trouvait mignon, le taquinait, lui donnait des petits surnoms. Il n’était pas amoureux d’elle, mais ces contacts furtifs avec sa chair blanche et moite le fascinaient. Il avait fini par coucher avec elle, une seule fois, ce qui lui avait permis de ne pas arriver puceau à son service militaire, et de suivre les autres sans trop d’appréhension quand ils avaient voulu l’entraîner dans une maison close à la première permission. Il n’avait pas aimé ces rapports tarifés, sans amour, et, hormis quelques images obsédantes qui persistaient dans ses rêveries nocturnes, il avait décidé d’attendre de rencontrer la bonne personne avant de retenter l’expérience.
À son retour dans la vie civile, lorsqu’il avait obtenu le poste qu’il occupe encore à la mairie d’Armentières, les grands yeux clairs de Jeanne avaient alors croisé sa route, et, pour la première fois de sa vie, il s’était autorisé à être romantique. C’était elle, et pas une autre. Il devait l’épouser. Pourtant, leur premier contact n’avait pas été très prometteur. Elle accompagnait alors sa mère pour une histoire d’acte à retirer, et, lorsqu’il lui avait annoncé le délai d’attente pour obtenir ce papier, elle s’était mise en colère, comme s’il en était personnellement responsable.
Loin de l’agacer, ce petit coup d’éclat l’avait amusé, et il avait retourné la situation en sa faveur en soulignant que cela lui donnerait l’occasion de la revoir. Lorsqu’elle était revenue – sans sa mère – huit jours plus tard, il lui avait proposé une limonade pour se faire pardonner de cette longue attente, et leur histoire était née. Les joues de Jeanne n’avaient plus rosi de colère, mais du plaisir de le revoir uniquement.
Il retrouve parfois cette jeune femme qu’il a connue, innocente et sensible, au détour de certaines conversations, de certains gestes et attentions qu’ils ont encore de temps en temps l’un pour l’autre, mais ils parlent si peu de ce qui les anime vraiment, au fond… Il ignore s’il s’agit de pudeur, d’une éducation religieuse trop rigide ou encore d’autre chose, mais avec Jeanne, il se sent empêché.
Et il sait au fond de lui que cet empêchement est réciproque. Son épouse est courageuse, déterminée, aimante et attentionnée avec leurs enfants, et cela devrait lui suffire pour savoir qu’il a fait le bon choix en l’épousant. Mais pour elle ? S’agissait-il vraiment d’un choix ? Ou d’un renoncement ? Il se pose encore la question.
[1] Défense antiaérienne
[2] La maladie bleue désignait autrefois certaines malformations cardiaques congénitales provoquant une cyanose. Aujourd’hui, elles sont bien connues et peuvent être opérées avec succès.
[3] Fête foraine traditionnelle du Nord de la France, organisée chaque année sur la place d’un village ou d’un quartier.
* En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.


Vous devez être connecté pour poster un commentaire.